|

Quelques précisions
sur la République de Panama
Capitale: Panamá
Population: 2,7 millions (2001)
Langue officielle: espagnol
Le Panamá est divisé en neuf provinces et des territoires autonomes
particuliers, les comarcas.
On peut définir les comarcas comme des districts territoriaux réservés aux
populations autochtones qui bénéficient d'une certaine autonomie politique
et administrative.
On compte cinq comarcas indigènes: la comarca Kuna Yala, la comarca d'Emberá-Waunan,
la comarca de Ngobe-Buglé, la comarca de Kuna Madugandí, la comarca de
Wargandí.
Au point de vue ethnique, le Panama compte environ 65 % de Métis («Mestizos»,
15 % de Noirs, 10 % d’Européens descendants des Espagnols, 8,3 %
d’Amérindiens («Indígenas») et plus de 2 % d’Asiatiques (des Chinois).
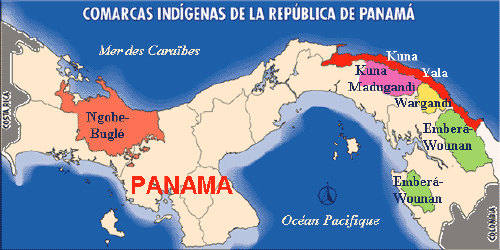
Selon les données décennales de l'année 2000, on comptait 234 400
indigènes au Panama, ce que signifie 8,3 % du total des habitants du pays.
Ces indigènes sont divisés plusieurs ethnies, bien que les deux tiers du
total appartiennent au groupe des Guaymí (presque 150 000 personnes) et 25
% du groupe Kuna (plus de 58 000). Au total, le pays compte sept peuples
indigènes, dont un grand nombre dans des régions dotées d’une certaine
autonomie, les comarcas:
Avant l’arrivée des Européens, ce sont les Amérindiens kuna, choco et
guaymi, qui occupaient cette région doublement stratégique, reliant
l'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud et séparant l'océan Pacifique de
l'océan Atlantique.
C’est Rodrigo de Bastidas, un rival de Christophe Colomb, qui découvrit la
région en 1501. L'année suivante, Christophe Colomb revendiqua le
territoire au nom de l'Espagne. La région fut explorée en 1513 par Vasco
Núñez de Balboa, le gouverneur espagnol du territoire qui, le premier,
traversa l’isthme et atteignit le Pacifique.
La ville de Panamá (mot signifiant «zone riche en pêche»), fondée dès
1519, devint le point de départ de toutes les expéditions coloniales
espagnoles vers le nord et le sud du continent. C’est par cet axe
stratégique que passait tout l’argent du Pérou. C’est pourquoi la colonie
suscita la convoitise des corsaires hollandais, français et anglais, qui
l'attaquèrent à maintes reprises, ce qui nuisit à la prospérité de Panama.
Pour se défendre, les Espagnols fortifièrent la côte est. Cela n’empêcha
pas le Britannique Henry Morgan de s’emparer de la ville de Panama en
1671.
Dépendant au début de la vice-royauté du Pérou, le Panamá fut ensuite
intégré à la Nouvelle-Grenade au début du XVIIe siècle, puis de la
Colombie, mais resta sous la domination espagnole jusqu'en 1821. C’est
durant cette période que la population se métissa et que la langue
espagnole se répandit dans tout le pays, sauf chez les indigènes.
Au cours de la colonisation espagnole, le roi d'Espagne, Charles Quint,
commanda une étude en 1523 pour préparer un premier projet d’un canal sur
l’isthme de Panamá. Un plan des travaux fut même élaboré dès 1529. En
1534, un notable espagnol proposa un projet de canal proche de celui qui
existe aujourd’hui. Il y eut par la suite plusieurs propositions, mais
rien ne fut réellement entrepris. Puis, en 1819, le gouvernement espagnol
donna l’autorisation officielle de construire un canal et de créer une
compagnie commerciale pour effectuer cette construction...sans résultat,
car avec la révolte des colonies l’Espagne perdit le contrôle des
emplacements susceptibles d’être utilisés pour sa construction.
Dès la fin de la domination espagnole en 1821, le Panama fut rattaché à la
république de Grande-Colombie, créée sous l'égide de Simón Bolívar. En
1826, Bolívar réunit les gouvernements des États de la Grande-Colombie
(Venezuela, Colombie, Équateur et Panama), à Panamá, lors du congrès
panaméricain, afin de construire avec eux l'unité du continent
sud-américain. Il mourut cependant en 1830, avant d'avoir consolidé cette
unification. Dès la dissolution de la république de Grande-Colombie,
chacun des États se retrouva politiquement autonome, mais le Panama
continua de faire partie de la Colombie, dont il constituait une province.
Entre 1850 et 1855, les États-Unis achevèrent la construction d’une voie
ferrée au Panama, reliant l'Atlantique au Pacifique et ce fut un Français,
Ferdinand de Lesseps, qui, en 1880, réalisa une première tentative
concrète, avec la Compagnie universelle du canal interocéanique. De
Lesseps, le père du canal de Suez, avait créé une compagnie faisant appel
à l’épargne privée en France. Les travaux furent interrompus, neuf ans
plus tard, en raison d'un grave scandale politico-financier qui secoua la
IIIe République française et de difficultés diverses (épidémie de fièvre
jaune, accidents de terrain, faillite, etc.).
En 1903, la Colombie refusa aux États-Unis le droit d'achever le canal. En
réaction, les États-Unis «incitèrent» le Panama à se soulever. Le 3
novembre de cette même année, la Colombie dut alors se départir du Panama,
qui devint la république du Panama.
Sous le couvert d’un Traité de paix et d’amitié, les Américains
débarquèrent dix fois sur le territoire du Panama entre 1856 et 1902.
Beaucoup d'Américains ont alors cru sincèrement que l’armée des États-Unis
avait soutenu le peuple panaméen dans son aspiration à la liberté et dans
son désir de se libérer de l’oppression colombienne. Cette même année, le
président américain, Théodore Roosevelt, avait sanctionné la loi Spooner
qui devait lui permettre de s’approprier une bande de 16 km de large pour
la construction du canal et maintenir des «droits perpétuels» sur la zone.
En réalité des troupes américaines furent envoyées pour «soutenir» le
nouveau gouvernement panaméen et le Panama fut contraint de signer un
traité avec les États-Unis par lequel ces derniers entreprenaient la
construction d'un canal interocéanique à travers de l'isthme de Panamá. En
1904, les États--Unis achetaient à la Compagnie française du Canal ses
droits et propriétés pour une somme de 40 millions de dollars. Deux
semaines après, et en échange de 10 millions de dollars, le traité
Hay-Brunau-Varilla concédait aux États-Unis «l'usage à perpétuité» d'un
canal encore à creuser et d'une zone de huit kilomètres sur chacune de ses
rives, ainsi que la «totale souveraineté» sur cet ensemble. En retour, les
États-Unis garantissaient l'indépendance du Panama. En fait, il devait y
avoir deux gouvernements: un pour le Canal (américain) et un pour le pays
(panaméen).
Le canal fut achevé par les Américains en 1914 pour un coût d'environ 387
millions de dollars. Il mesurait quelque 80 km de longueur. Les États-Unis
demeurèrent propriétaires de la zone du canal («Canal Zone»), soit 16 km
de large sur 80 km de long. Ce fut, jusqu’à la rétrocession du canal, un
État dans l’État, ce qui permettait dans un cadre «pacifique» de maintenir
une présence militaire américaine dans la région. Dans cette «Canal Zone»,
Washington déploya jusqu'à 10 000 soldats distribués dans 14 casernes et
forts.
Le lieu devint le centre d'entraînement des forces armées américaines et
d'Amérique latine, un centre d'espionnage continental et une base d'appui
aux opérations de contre-insurrection.
Bref, la «Canal Zone» recouvre un territoire 1474 kilomètres carrés sur
lequel Washington exerçait une totale souveraineté: un État indépendant
créé de toute pièces par et pour les États-Unis.
Depuis l’ouverture du canal, l’économie du Panama dépend en partie de la
rente annuelle versées par les administrateurs du canal et des milliers
d’emplois — environ 8000 — créés pour son entretien. La langue anglaise
s’installa dans le pays et fit concurrence à l’espagnol. Dans la zone du
canal, temples, églises, bureaux administratifs, médias, commerces, etc.,
tout ne fonctionnait qu'en anglais.
Cependant, depuis l'indépendance, la vie politique du Panama a connu de
nombreux soubresauts, car les relations avec les États-Unis demeurèrent
tendues.
En 1953, le gouvernement panaméen accorda aux autochtones, les Kunas, une
grande autonomie dans la comarca de San Blas (les îles de San Blas),
aujourd'hui «Kuna Yala»; par les suite, cette autonomie fut étendue à
quatre autres communautés autochtones: Emberá (1983), Ngobe-Buglé (1997),
Kuna Madugandí (1996) et Wargandí (2000).
Finalement, le commandement américain des forces spéciales pour le sud (Socsouth)
devait quitter Panama pour s'installer, à l'été 1999, à Porto Rico. La
création d’un «centre international de lutte contre la drogue» — Centre
multilatéral antidrogue — pour la sécurité du trafic interocéanique
devrait néanmoins maintenir sur place une présence militaire américaine.
La concession du canal fut confiée à une entreprise de Hong-Kong. En
effet, c’est la société Hutchison Whampoa, dont le siège est à Hong-Kong,
qui s'est assuré la gestion (pour les prochains 25 ans) des ports de
Cristobal (côte atlantique) et de Balboa (côte pacifique). En somme, après
l’«Oncle Sam», ce serait au tour de l'«Oncle Tchang»!
Ce n’est pas pour rien que les Panaméens ont toujours dit: «No hay
democracia en Panama porque no conviene a los gringos» («Il n'y a pas
démocratie en Panama parce que cela ne convient pas aux étrangers»).
Quoiqu'il en soit la politique vis a vis des indigène diffère profondément
de celle des autres états d'amérique latine: après un conflit armé en 1925
— la «révolution Tule» — avec les autochtones (qui avaient alors constitué
une république autonome), une loi en 1938 créait la première comerca de
San Blas, un territoire caractérisé par une autonomie politique et
administrative pour les Kunas.
L’ancienne organisation politique des Kunas a été améliorée par des «Congresos
Locales» (communautés) et des «Congresos Generales» (comarcas) qui ont
contribué à conserver une forte cohésion du groupe et maintenir le pouvoir
de décision sur les activités effectuées sur leur territoire, puis exercer
le contrôle sur leurs ressources naturelles ou d'autres ressources de la
région.
D'autres suivirent pour d'autres ethnies cependant, on compte quelque 48
communautés Emberá-Waunan réparties dans la province de Darién et dans une
partie de l'est de Panama dont les membres sont demeurés hors de la
comarca et qui luttent pour la reconnaissance de leurs terres collectives.
Au total, on compte cinq comarcas autochtones: la comarca Kuna Yala, la
comarca d'Emberá-Waunan, la comarca de Ngobe-Buglé, la comarca de Kuna
Madugandí, la comarca de Wargandí. Le Panama est l’un des rares États
d’Amérique latin a avoir adopté ce mode d’autogouvernement à l’intention
de ses autochtones. Ceux-ci peuvent adopter des lois dans la mesure où
elles ne contreviennent pas aux dispositions constitutionnelles de la
République, ni aux lois du pays.
Malgré cette disposition constitutionnelle, les peuples indigènes de
Panama se sont trouvés devant un énorme défi: défendre leurs territoires
contre les exploitants étrangers des ressources minières. Malgré cette
reconnaissance constitutionnelle, le processus juridique reste néanmoins
basé sur un Code minier (Código Minero) désuet datant de 1963. Le Code
minier ne reconnaît pas dans sa totalité l'intégrité et le respect des
régions indigènes. Pour beaucoup de Panaméens, les autochtones sont encore
considérés comme des «ennemis du développement» («enemigos del desarrollo»)
économique et restent isolés du «progrès».
et dans les faits, la plupart des activités minières entraînent des
conséquences écologiques importantes sur la flore, la faune et les eaux,
ce qui oblige le gouvernement à déplacer des populations autochtones
entières vers d’autres lieux de résidence.
Ce n’est pas pour rien que le Comité pour l’élimination de la
discrimination raciale de l’Organisation des Nations unies (le 14e rapport
périodique de 1996) mentionnait que «la question des droits fonciers des
populations autochtones n’a pas été réglée dans la grande majorité des
cas» et reconnaissait que ces droits semblent «menacés par les activités
minières entreprises par des sociétés étrangères, avec l’accord des
autorités centrales», et par le développement du tourisme dans les régions
habitées par les populations autochtones.
Soulignons enfin que le gouvernement de Panama n'a pas encore signé ni
ratifié la Convention relative aux peuples indigènes de l’Organisation
internationale du travail (OIT). Pourtant, beaucoup d'États
latino-américains l'ont ratifiée: l’Équateur, la Bolivie, le Paraguay, le
Pérou et, en Amérique centrale, le Guatemala, le Costa Rica, le Honduras
et l’Argentine. Il est vrai que la Convention est plus ou moins appliquée
dans la plupart des pays et qu'une ratification qui ne s'accompagne pas de
mesures destinées à la mettre en vigueur reste inutile. Il est probable
que c'est là le point de vue du gouvernement panaméen
En fait, l’éducation primaire est généralement donnée dans la langue
autochtone lors de la première année scolaire. Par la suite, les élèves
passent à l’espagnol. On invoque le fait que les écoles manquent de
manuels et d’enseignants bilingues qualifiés. La plupart des professeurs
viennent de Panamá Ciudad et ils donnent leurs cours en espagnol, car ils
ignorent les langues indigènes.
Les autochtones estiment aussi qu’il est difficile de parler des droits
humains, de démocratie et d’équité, alors qu’ils sont impliqués contre
leur gré dans des projets économiques néo-libérales qui accentuent les
différences entre les plus riches et les plus pauvres. Alors qu’ils
représentent 10 % (sic) de la population panaméenne, 95,4 % des indigènes
vivent sous le deuil de la pauvreté et 86,4 %, dans une «extrême
pauvreté».
Ils affirment également partager «comme d'autres peuples indigènes» une
«triste histoire» soumise aux politiques qui ont provoqué l’invasion de
leurs territoires, la modification de la bio-diversité, la violation des
accords nationaux et internationaux, la discrimination, le génocide, les
conditions sanitaires précaires et les difficiles conditions de vie
propres aux peuples opprimés.
En somme, la situation des autochtones panaméens ne semble pas être
meilleure que dans la plupart des pays latino-américains.
-------------------------------
http://www.tlfq.ulaval.ca/AXL/amsudant/panama.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
|
