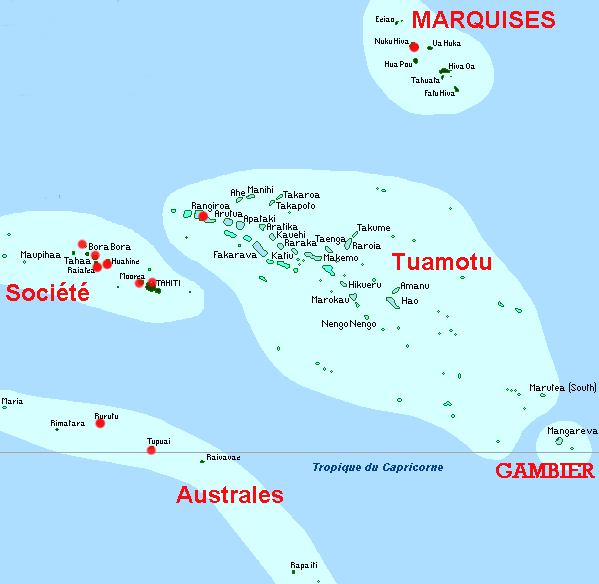| Petite introduction
sur la Polynésie


4167
km2, 260000 habitants la Polynésie
est un ensemble d’archipels Français du Pacifique, environ 6 000 km à
l’est de l’Australie. Elle comprend les îles du Vent, les îles
Sous-le-Vent, les îles Tuamotu, les îles Gambier, les îles Marquises et
les îles Australes, ainsi que les espaces maritimes adjacents.
Principales caractéristiques de la population : la jeunesse (les moins de
25 ans comptent pour la moitié, contre 30% environ en France
métropolitaine), et son inégale répartition.
La population est très concentrée : à elle seule, l'île de Tahiti
rassemble 70% des Polynésiens, contre 7% pour les Tuamotu-Gambier, 3,6%
pour les Marquises et 3% pour les Australes.
Sur l'île même de Tahiti, le
déséquilibre se poursuit : le "grand Papeete", zone urbaine littorale
hypertrophiée qui s'étend sur plus de 30 km entre Punaauia à l'est et Arue
à l'ouest, rassemble plus de 120 000 habitants, alors que le reste de
l'île est complètement sauvage ou presque. Le contraste est saisissant
entre Papeete la moderne, la bruyante, et les îles, au rythme de vie
encore villageois, et certains atolls reculés, réduits parfois à une
micro-communauté d'une cinquantaine d'habitants vivant presque en
autarcie.
Ce déséquilibre s'accentue d'ailleurs. Le fossé se creuse entre Papeete, qui attire
beaucoup d'îliens, et le reste de la Polynésie.
Le dépeuplement de
certaines îles est un réel problème. Trop isolées, enclavées, certaines
voient ainsi une partie de leur population rejoindre Papeete.
La majeure partie de la population occupe aujourd'hui les zones
littorales, alors qu'aux temps anciens, elle vivait dans les vallées, à
l'intérieur des îles, comme l'attestent les vestiges archéologiques.
La Polynésie est un extraordinaire hymne au métissage.
Au cours de son histoire, elle a fait preuve d'une extraordinaire
faculté d'assimilation, et Tahiti est un creuset culturel où se fondent
toutes les communautés.
Les origines ou la couleur de peau ne posent pas
problème, et le brassage ethnique est une donnée immanente à la société
polynésienne.
La souche maohie, issue des premiers navigateurs, a intégré les
apports étrangers depuis plusieurs siècles déjà, et la multiculturalité
est inscrite dans les faits. Malgré tout, on fait communément référence à
quatre groupes au sein de la population de Polynésie française : les
Polynésiens, les métis (appelés Demis: Polynésiens-Européens ou
Polynésiens-Chinois), les Européens et les Chinois . Mais cette distinction est théorique puisque,
dans les faits, l'ensemble de la population s'est, à des degrés divers et
à des époques différentes, métissée lors des contacts avec l'extérieur.
Les Polynésiens maohis comptent pour 66,5% de la population, les Demis
16,3%, les Européens (popaa) sont estimés à 11,9% et les Asiatiques à
4,7%.
Les Demis sont principalement issus de mariages mixtes qui eurent
lieu à la fin du siècle dernier et au début du XX' siècle entre les
colons, les administrateurs ou les commerçants européens et les femmes
appartenant à des grandes familles polynésiennes
.Les Polynésiens maohis, moins favorisés, sont surtout représentés
dans les secteurs d'activité traditionnels, pêche et agriculture, et dans
le secteur secondaire (bâtiment et construction). Ils vivent plutôt dans
les villages et dans les îles, alors que les Demis sont plutôt représentés
à Papeete.
Les premiers Chinois, Hakkas et Puntis, débarquèrent au milieu du
XIX` siècle pour travailler dans les plantations de coton. Une seconde
vague d'immigration eut lieu au début du XX' siècle. Pourtant, la
citoyenneté française ne leur fut accordée qu'en 1964. Partis de peu, ils
illustrent des modèles d'ascension sociale et sont surtout représentés
dans le secteur du commerce et des affaires. A la différence d'autres
diasporas chinoises dans le monde, ils ne vivent pas dans un "Chinatown"
géographiquement circonscrit. Parfaitement intégrés à la vie polynésienne,
ils n'en continuent pas moins à préserver certaines de leurs traditions.
Quant aux popaa, il s'agit essentiellement de Français installés
pour quelques années en Polynésie, venus profiter d'un certain nombre
d'avantages liés à leur statut (salaires doublés pour les fonctionnaires,
absence d'impôts sur le revenu et primes diverses) : professeurs,
militaires, personnel médical, fonctionnaires, restaurateurs ou
prestataires de tourisme. Ils sont surtout présents à Tahiti et à Moorea.
Peu d'entre eux sont nés en Polynésie sans s'être métissés, et il n'y a
pas, comme dans d'autres DOM-TOM, des Caldoches, des zoreilles ou des
békés. L'origine géographique des
Polynésiens reste encore, en partie, une énigme sur laquelle se
penchent archéologues, linguistes et anthropologues depuis de longues
années.
Malgré la théorie d'une origine sud-américaine, qu'avait voulu illustrer
Thor Heyerdahl lors de l'expédition du Kon-Tiki en 1947 entre le Chili et
la Polynésie, les spécialistes estiment désormais que les peuples
polynésiens sont originaires du Sud-Est asiatique, qu'ils quittèrent à
bord de grandes pirogues voici 3 000 à 4 000 ans.
L'arrivée de l'homme en Australie est datée d'au
moins 40 000 ou 45 000 ans (généralement accepté comme un minimum). Le
maximum peut atteindre 70 000 ans. Des épisodes répétés de glaciation
durant le pléistocène se sont traduits par des abaissements du niveau de
la mer de 100 à 150 mètres.
A cette époque l’Asie du Sud-Est insulaire n’était pas l'archipel
qui existe aujourd'hui mais constituait un plateau continental, celui
de Sunda, prolongement en forme de péninsule du continent asiatique.
Le rivage continental s'étendait bien plus en avant dans la mer du Timor.
L'Australie et la Nouvelle-Guinée, étaient reliées entre elles par un pont
terrestre et formaient une masse continentale unique appelée Sahul
qui englobait également la Tasmanie.
Il y a 6 000 ans, avec la fin de la période des glaciations, le niveau des
mers remonte à son niveau actuel, submergeant le pont terrestre entre
l'Australie et la Nouvelle-Guinée. Les populations de Nouvelle-Guinée,
d'Australie et de Tasmanie vont désormais connaître un développement
séparé. Les ancêtres des Papous de Nouvelle-Guinée, tout au moins ceux des
hautes terres, vont mettre en place un système d’horticulture complexe
dont les premières traces remontent à il y a 9 000 ans, soit à une date
tout juste postérieure à celles retrouvées en Mésopotamie et que l’on
désigne généralement comme les plus anciennes. À l'inverse, les aborigènes
d'Australie demeureront des chasseurs-cueilleurs, les conditions
géoclimatiques (ou les ressources cynégétiques) étant moins favorables à
l'agriculture. Il y a 5 000 ans (3 000 av.
J.-C), des habitants du littoral de la Chine du Sud, cultivateurs de
millet et de riz, commencent à traverser le détroit pour s'installer à
Taiwan. Vers 2 000 avant J.-C., des migrations ont lieu de Taiwan vers les
Philippines. De nouvelles migrations commencent bientôt des Philippines
vers Célèbes et Timor et de là, les autres îles de l'archipel indonésien.
Vers 1 500 av. J.-C., un autre mouvement mène des Philippines en
Nouvelle-Guinée et au delà, les îles du Pacifique. Les Austronésiens sont
sans doute les premiers grands navigateurs de l'histoire de l'humanité.
Ces populations austronésiennes qui s’installent en Océanie ont une autre
caractéristique : ce sont des potiers. Le père Otto Meyer sera le premier
à découvrir ces poteries en 1909 sur l'île de Watom, dans l'archipel
Bismarck (actuellement en Papouasie-Nouvelle Guinée). En 1917, le géologue
Maurice Piroutet en trouva à son tour dans une localité du nord de la
Nouvelle-Calédonie appelée Lapita. Ce nom fut par la suite retenu par les
archéologues pour désigner l'ensemble de ces poteries et le complexe
culturel qui y est associé, qui caractérise une aire allant de la
Nouvelle-Guinée aux îles Tonga et Samoa. Divers chantiers de fouilles vont
tout au long du XXe siècle, mettre à jour d'autres exemplaires de ces
poteries sur toute la partie occidentale du Pacifique (ou Océanie proche),
les îles Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie, les Fidji, Wallis et
Futuna jusqu'aux Samoa. L’un des mystères de
ces Lapita est que l'on n'en a jusqu'à aujourd'hui retrouvé aucune trace à
l'est des Samoa. C'est la raison pour laquelle certains chercheurs ont
évoqué l’idée que les habitants de la Polynésie orientale, qu'on appelle
maintenant Océanie éloignée, ne seraient pas passés (ou alors sans y être
restés longtemps) par ce qu'on appelle traditionnellement la Mélanésie
mais plus au nord par les Philippines et la Micronésie. Des recherches
génétiques récentes ont néanmoins montré que ceux qu'on appelle
"Polynésiens" et "Mélanésiens" avaient la même origine
Une autre interrogation a été de se demander la raison qui pouvait
pousser ces populations à s'enfoncer toujours plus loin vers l'est, alors
même que vents et courants dominants leur étaient contraires.
Premier élément de réponse, cela a mis plus de 3 000 ans. Les archéologues
ont également évoqué la possibilité que ces vagues migratoires n'avaient
lieu que durant les périodes où apparaissait le phénomène El Niño. Enfin,
une autre explication plus pragmatique a été avancée ces dernières années.
Les Austronésiens voyageaient à bord de pirogues qui, d’après ce que l’on
peut en savoir par la tradition orale, et certains preuves archéologiques
ou historiques, pouvaient embarquer jusqu’à une cinquantaine de passagers.
Les provisions ne pouvaient être que limitées. Ainsi, en naviguant contre
le vent, ils étaient certains qu’en cas d’échec dans la découverte de
nouvelles terres à peupler de pouvoir revenir rapidement à bon port
profitant cette fois-ci d’un vent arrière. Cette théorie doit néanmoins
être modulée en fonction des expérimentations menées à bord de répliques.
Les "pahi" remontaient très mal contre le vent mais étaient très à l'aise
aux allures proches du vent de travers. Dès lors, et compte tenu de la
direction des vents dominants, l'alizé de SE en particulier, on peut
imaginer soit des traversées en zigzags, soit des traversées à 70 ou 80%
du vent. Néanmoins selon l'ethnologue néo-zélandais Elsdon Best le vent
n'était pas l'unique moyen de propulsion de ces embarcations, "bien que
les voiles étaient employés par les navigateurs maori, ramer était la
méthode la plus commune"
La nuit les étoiles étaient un précieux repère. Les navigateurs
organisaient un relais d'étoiles repères, ce « chemin d'étoiles »
demandait sans doute un long apprentissage ainsi qu'une grande attention
pour le pilote.
La course du soleil n'étaient utilisable qu'une partie de la journée.
La houle comme les vents dominants, à condition d'en avoir une bonne
connaissance, deviennent des repères de direction assez stables. Un grand
nombre de langues océaniennes témoignent en effet de ce savoir ancien.
Vu la faible taille de certaines îles, s'en
approcher n'était pas suffisant, il fallait encore les trouver
précisément. Pour cette localisation « cabotière » les navigateurs usaient
d'une gamme variée de repères .La présence d'oiseaux indique une terre à
proximité, suivant l'espèce on peut évaluer la distance de la terre bien
avant de l'apercevoir. De plus le soir certaines espèces rentrent à terre
il suffit alors de suivre leur direction.
La couleur de la mer peut trahir la nature des fonds, ainsi le relèvement
des fonds indique la proximité d'une terre.
Dans certaines îles les étendues d'eau intérieure provoquent une
évaporation particulière.
La houle se déforme à l'approche des obstacles et à leur suite.
Des arguments tendent pour les scientifiques modernes à prouver que les
Polynésiens ont atteint le continent américain dont ils ont ainsi ramené
la patate douce (et le nom).
Un millénaire environ s'écoula avant la deuxième grande vague de migration
vers l'est, qui dura à peu près du début de l'ère chrétienne à l'an 600,
dépassant les îles de la Société et les Tuamotu pour atteindre les îles reculées
des Marquises. Une nouvelle pause fut observée avant le mouvement
migratoire suivant, qui se déroula vers l'an 850 dans toutes les
directions, peuplant les îles Hawaii au nord, l'île de Pâques au sud-est
et les îles de la Société au sud-ouest. Un dernier flux amena le peuple
polynésien jusqu'aux îles Cook et la Nouvelle-Zélande, en passant par
Rarotonga, vers l'an 1000. De fait, les populations de Polynésie française
partagent avec les Hawaiiens et les Maoris de Nouvelle-Zélande des
ancêtres communs originaires des Marquises. En outre, tous ces groupes
humains localisés dans un immense triangle, le triangle polynésien,
dont les pointes sont Hawaii, l'île de Pâques et la Nouvelle-Zélande,
parlent une langue commune, le maohi.
Quant aux motivations qui poussèrent ces populations à émigrer, elles
restent assez obscures. Les thèses les plus couramment avancées font état
de guerres qui auraient forcé les vaincus à partir ou d'une pression
démographique trop forte sur des terres aux ressources alimentaires
limitées.
Bien que l'Histoire n'ait retenu que quelques noms, la découverte de la
Polynésie fut l'oeuvre de plusieurs circumnavigateurs espagnols,
hollandais, anglais, français et russes. Les premières approches du
Pacifique Sud eurent lieu au début du XVI` siècle, mais n'eurent aucune
suite. Ce fut véritablement au XVIII' siècle, fécond en grands voyages de
découverte, que l'histoire de la Polynésie bascula.
Pendant longtemps l' océan Pacifique est resté un monde en marge hors du
champs de connaissance des Européens.
En 1520, Fernand de Magellan se lança dans la traversée de ce vaste
océan. La seule île de Polynésie qu'il aperçut fut Puka Puka, située à
l'extrémité nord-est des Tuamotu.
En 1567, l'Espagnol Alvaro de Mendana de Neira appareilla d'Acapulco à la
recherche d'une grande terre australe qui constituera le graal des
explorations européennes durant les deux siècles suivants. Après avoir
découvert les îles Salomon, il aperçut en 1595 les îles Marquises,
l'archipel situé à l'extrémité nord-est de la Polynésie, qu'il baptisa Las
Marquesas de Mendoza, d'après le nom de l'épouse de son mécène, le
vice-roi du Pérou. Quirôs, son premier pilote, organisa en 1606 sa propre
expédition, à l'occasion de laquelle il découvrit plusieurs iles des
Tuamotu, avant de rallier les îles Cook et d'autres archipels du
Pacifique. Ce voyage marqua la fin des grandes explorations espagnoles
dans le Pacifique.
Les Hollandais, déjà fortement implantés dans les Indes
hollandaises (l'actuelle Indonésie), reprirent le flambeau en 1615-1616
avec Jacques Le Maire, qui traversa les Tuamotu en se dirigeant vers
l'ouest.
Ce ne fut qu'en 1722 que le Hollandais Jacob Roggeveen découvrit la
première des îles de la Société. Cette année-là, il parvint à l'île de
Pâques le jour de Pâques, puis prolongea sa route vers l'ouest, traversant
les Tuamotu et passant à Makatea pour gagner les îles de la Société où il
salua Maupiti, l'île haute située le plus à l'ouest de l'archipel.
Les Hollandais furent suivis par les Anglais, conduits en 1765 par
l'amiral John Byron, qui découvrit les dernières îles des Tuamotu encore
inconnues. En 1767 lui succéda l'expédition de Philip Carteret, qui
commandait le Swallow, et de Samuel Wallis, à la tête du Dolphin. En
contournant le cap Horn, les deux navires se perdirent de vue, chacun
poursuivant de son côté l'expédition à la recherche du mythique continent
austral. Carteret découvrit l'île Pitcairn, puis les îles Salomon,
ignorées depuis Mendana. Ce fut cependant à Wallis que revint
l'honneur d'être le premier Européen à visiter Tahiti.
Le Dolphin mouilla dans le lagon de Tahiti vers la fin du mois de juin
1767, mais un quart de l'équipage souffrait du scorbut, et Wallis, en
mauvaise santé, ne put quitter le navire durant la plus grande partie de
son séjour. Leur arrivée suscita d'abord la fascination des insulaires,
puis la curiosité cédant place à la peur, ceux-ci attaquèrent bientôt le
Dolphin. De violentes représailles s'ensuivirent.
Paradoxalement, la démonstration de force des Anglais ne retourna pas les
Tahitiens contre les explorateurs. Au contraire, les deux bords mirent en
place un commerce amical. L'équipage manquait de produits frais et les
Tahitiens, qui ne connaissaient pas le métal, furent ravis de recevoir en
échange des couteaux, des hachettes et des clous. L'équipage du Dolphin
contribua alors à l'émergence du cliché qui allait désormais être
durablement associé à Tahiti, celui d'un paradis sexuel, quand les
marins découvrirent qu'un simple clou pouvait servir de monnaie d'échange
pour obtenir les faveurs des Polynésiennes .!!!
Louis Antoine de Bougainville, le premier grand explorateur français dans
le Pacifique, arriva à Tahiti en avril 1768, moins d'un an après Wallis.
Ses deux navires, La Boudeuse et L'Étoile, furent ancrés à l'est de
la baie de Matavai. À cette époque, comme Wallis effectuait encore son
voyage de retour vers l'Angleterre, Bougainville ignorait toujours qu'il
n'était pas le premier Européen à découvrir cette île. Son séjour y fut
bref (9 jours), mais ce fut lui qui, en forgeant l'expression du "bon
sauvage" chère aux philosophes français du XVIII' siècle, inspira la
vision que devait développer Rousseau d'un nouveau paradis terrestre.
Ignorant que le drapeau anglais avait déjà été déployé sur l'ile,
Bougainville revendiqua Tahiti au nom de la France. Comme Wallis, il
devait à son tour être éclipsé par l'arrivée du plus grand explorateur du
Pacifique, l'Anglais James Cook.
Cook effectua trois grandes expéditions scientifiques dans le Pacifique
Sud entre 1769 et 1779. L'une de ses missions, patronnée par la Royal
Society de Londres, consistait à observer le passage de Vénus devant le
Soleil, à partir de Tahiti. La deuxième mission avait pour but la
découverte de la fameuse terre australe.
Cook, navigateur et cartographe hors pair, était entouré de spécialistes
de haut niveau, et les merveilles exotiques du Pacifique Sud purent Grâce
à se expéditions, être portées à la connaissance du public européen.
À bord de l'Endeavour, Cook arriva en avril 1769 à Tahiti, où il
séjourna trois mois avant de faire voile vers la Nouvelle-Zélande et
l'Australie. Cook retourna à Tahiti à l'occasion d'une deuxième expédition
en 1772-1775, puis lors d'une troisième en 1776-1780. Il trouva la mort au
cours d'un affrontement avec des Hawaiiens au début de l'année 1779. Alors
que Bougainville, lyrique, s'était contenté de rapporter de Tahiti l'image
d'un paradis, Cook et son entourage de scientifiques et d'artistes, plus
pragmatiques, ont légué un immense travail ethnographique et scientifique
sur Tahiti : outre l'étude de la flore et de la faune, ils rapportèrent
des descriptions de la société traditionnelle et des coutumes
polynésiennes, ainsi que de précieuses illustrations.
Les Espagnols, solidement implantés en Amérique du Sud,
considéraient le Pacifique comme leur arrière-cour et n'étaient guère
ravis d'apprendre que d'autres navigateurs européens s'étaient rendus à
Tahiti. Aussi, en 1772, le navire commandé par Don Domingo de Boenechea,
dépêché du Pérou, mouilla dans le lagon au large de Tautira, à Tahiti, et,
pour la troisième fois, revendiqua l'île au nom d'une nation
européenne. Au cours d'un second voyage, en 1774, Boenechea fonda le
premier établissement européen durable sur l'île, abritant deux
missionnaires et deux soldats, mais il se conclut par un échec et les
Espagnols renoncèrent à Tahiti. Après la dernière visite de Cook en 1779,
une pause d'une dizaine d'années fut observée, laquelle marqua la
transition entre la période précoloniale et les débuts de la colonisation.
Les contacts avec les explorateurs européens, pourtant relativement brefs,
vont se traduire par une réorganisation complète des structures du pouvoir
en place.
Avant l'arrivée des Européens, le pouvoir était exercé en Polynésie sur
une base essentiellement locale : les chefferies, très hiérarchisées,
organisées autour d'un marae . À la différence des sociétés
européennes, aucun pouvoir central ne détenait une autorité ou une
légitimité. Ainsi, Tahiti était divisée en de nombreuses chefferies qui,
lorsqu'elles se lassaient de se battre les unes contre les autres,
s'attaquaient à Moorea. De même, les chefs belliqueux de Bora Bora
effectuaient de fréquentes et sanglantes incursions sur l'île voisine de
Raiatea, en raison du manque de terres arables dont souffrait leur île.
Mais aucun souverain n'était assez puissant pour étendre très loin sa
suprématie. L'introduction des armes européennes bouleversa cet état de
fait.
Les Tahitiens, qui comprirent vite l'importance de l'armement européen,
pressèrent les Occidentaux de prendre parti dans leurs conflits
insulaires. Cook et les autres explorateurs s'opposèrent énergiquement à
de telles propositions, mais pas les mutinés du Bounty.
( je vous raconterai l'histoire complète quand nous
serons à Tahiti...puis à Pitcairn...)
Ceux-ci proposèrent leurs services de mercenaires au plus
offrant, c'est-à-dire aux Pomare. Le roi Pomare Ier, le premier
représentant de la dynastie, s'appelait auparavant Tu et était le neveu d'Obarea,
une ambitieuse cheffesse, qui s'était liée d'amitié avec Wallis, puis Cook
et surtout Banks, qui l'avaient prise pour la "reine" de Tahiti.
Avant l'arrivée du Bounty, les Pomare n'étaient simplement qu'un clan
parmi d'autres luttant pour le pouvoir à Tahiti, et certainement ni le
plus important ni le plus prestigieux. Grâce aux armes fournies par les
mutinés, ils réussirent à étendre progressivement leur souveraineté à
l'ensemble de Tahiti. Pomare I" dominait déjà la majeure partie de Tahiti
l'année de sa mort en 1803, avant que son fils Pomare II ne le
remplace sur le trône.
L'isolement de la Polynésie va progressivement se rompre sous l'effet
conjugué de l'arrivée de missionnaires et de commerçants, qui
convoitaient Tahiti pour des raisons différentes. Dans les deux cas, les répercussions
furent désastreuses : la société polynésienne faillit se désintégrer
suite à ce choc de deux civilisations.
Alors que les descriptions de Tahiti et de ses habitants alimentaient
maintes spéculations intellectuelles en Europe quant à la notion de "bon
sauvage", le clergé décida rapidement de faire quelque chose pour ces
sauvages, qu'ils fussent bons ou non. C'est la London Missionary Society
(LMS), dont la vocation était de" sauver du paganisme "les populations
nouvellement découvertes, qui prit l'initiative. Pour remplir cet
objectif, trente pasteurs montèrent à bord du Duff pour aller évangéliser
le Pacifique. Au mois de mars 1797, vingt-cinq d'entre eux débarquèrent à
la pointe Vénus et se mirent prestement au travail, la réussite de leur
entreprise se mesurant au nombre de temples protestants qui ponctuent
aujourd'hui l'ensemble des îles de la Société, des Tuamotu et des
Australes.
Les missionnaires étaient certainement animés des meilleures intentions,
mais les conséquences de leur présence furent souvent désastreuses sur la
culture locale. Ils firent interdire les danses et les chants, jugés "impudiques",
ainsi que les relations sexuelles hors mariage, décrétèrent le port de
vêtements couvrant tout le corps (d'où l'existence des "robes
missionnaires", toujours en usage), firent proscrire les tatouages et les
parures de fleurs portées dans les cheveux et imposèrent le respect du
silence le dimanche.
Des visiteurs d'un autre genre, les baleiniers, bouleversèrent
également, à leur façon, la société polynésienne. Ils commencèrent à
fréquenter les eaux polynésiennes dans les années 1790, avant même
l'arrivée des premiers missionnaires. Provenant d'Angleterre, puis plus
tard, de Nouvelle-Angleterre, État des États-Unis depuis peu indépendant,
ces marins souvent peu scrupuleux chassaient la baleine dans l'hémisphère
Sud durant les mois d'été puis faisaient relâche l'hiver dans des îles
comme Tahiti. À terre, après les rudes conditions de la vie à bord, les
équipages se livraient à toutes les turpitudes. Ils introduisaient
l'alcool et des maladies ( Syphillis et vénériennes). Des négociants
originaires des colonies pénitentiaires d'Australie se manifestèrent
également, échangeant des armes contre des denrées alimentaires,
encourageant la prostitution et créant des distilleries. Indifférents,
sans réaction et souffrant de maladies contre lesquelles ils n'étaient pas
naturellement immunisés, les Tahitiens virent leur population décroître
très rapidement, et faillirent purement et simplement disparaître.
L'ascension des Pomare date de 1815. Pour étendre son
influence, le
roi fin stratège, s'était converti au christianisme par pragmatisme plus
que par conviction et s'appuya sur les missionnaires anglais, dont
l'emprise sur la société était grandissante - ils interféraient aussi bien
dans les affaires publiques qu'économiques du royaume. Il consolida
définitivement son pouvoir sur les îles Sous-le-Vent en 1815, lors de la
bataille de Fei Pi, au cours de laquelle il soumit les chefs
traditionnels, hostiles à toute alliance avec les chrétiens.
Poussé par les missionnaires, Pomare II
alla plus loin encore en faisant accepter en 1819 par les grands chefs et
le peuple un code de lois qui restera dans l'Histoire comme le "Code
Pomare", qui mit officiellement hors la loi des pans entiers de la culture
polynésienne. Pomare II mourut en 1821, probablement d'un excès de
boisson.
Son fils Pomare III lui succéda. Il décéda à peine 6 ans plus tard, en
1827, et fut remplacé sur le trône par la jeune reine Pomare IV.
Son règne dura 50 ans, au cours desquels elle étendit sa souveraineté à
d'autres îles des Australes et conclut des alliances stratégiques avec
plusieurs îles de la Société. Elle vécut suffisamment longtemps pour voir
son territoire tomber aux mains des Français.
À cette époque, les grandes puissances coloniales européennes étaient
toujours à la recherche de nouvelles colonies pour étendre leur influence
et se livraient à une véritable course-poursuite. Le Pacifique Sud faisait
l'objet de la convoitise des Français et des Anglais. Tahiti représentait
encore un territoire vierge, susceptible d'intéresser les deux nations. À
leur manière, les missionnaires incarnaient la puissance coloniale : les
protestants anglais régissaient les îles de la Société, les Australes et
les Tuamotu, tandis que les missionnaires catholiques français, qui
s'étaient implantés aux Gambier en 1834 et aux Marquises en 1838,
exerçaient leur pouvoir dans ces deux archipels. La rivalité entre ces
deux courants religieux pour le contrôle, non seulement spirituel mais
aussi politique de la Polynésie, était manifeste.
En 1836, les pères français Honoré Laval et François Caret quittèrent les
Gambier pour débarquer discrètement non loin de Tautira, à l'extrémité
orientale de Tahiti. Cet accostage clandestin dans un lieu reculé
s'explique par l'animosité que nourrissaient les missionnaires protestants
anglais à l'égard de toute présence catholique à Tahiti. Lorsqu'ils
arrivèrent à Papeete, ils furent aussitôt arrêtés et expulsés par la reine
Pomare IV, encouragée par un pasteur protestant, Pritchard. Cet acte mit
le feu aux poudres.
La France, qui en fait détenait déjà une entière souveraineté sur les
Marquises, considéra le départ forcé de ses deux missionnaires de Tahiti
comme un camouflet. Demandes de réparation, réclamations,
contre-réclamations, indemnités et excuses se succédèrent par la voie
diplomatique jusqu'en 1842, année au cours de laquelle l'amiral
Dupetit-Thouars imposa le protectorat français sur Tahiti. Il s'ensuivit
une période de troubles. L'ordre nouveau institué par les Français fut
durement ressenti et la reine Pomare espérait que la Grande-Bretagne
allait réagir mais cette dernière prit seulement acte de la situation. En
fait, la rébellion vint des Tahitiens eux-mêmes.
Pendant près de 3 ans, de 1844 à 1846, Français et Tahitiens se livrèrent
une guerre sanglante. Les fortins français bâtis autour de Tahiti
témoignent de l'âpreté de la résistance insulaire, mais les rebelles
furent soumis ; en 1846, la France régnait sans partage sur Tahiti et
Moorea. Si la reine Pomare IV, qui s'était exilée à Raiatea, fut
convaincue en 1847 de revenir à Tahiti, elle n'était désormais plus qu'un
prête-nom, les Français étant désormais maîtres de la situation.
La reine Pomare mourut en 1877 ; lui succéda son fils, Pomare V qui
abdiqua en 1881 et mourut en 1891. Sous son règne, un pas supplémentaire
fut franchi dans la voie de la colonisation : jugeant le statut de
protectorat trop fragile, les Français firent pression sur Pomare V pour
qu'il cède ses États à la France. Ils parvinrent à leurs fins en
juin 1880: Tahiti devint alors officiellement une colonie française.
Reste que la souveraineté française ne s'exerçait pas à l'origine sur
l'ensemble des îles de la Société, car certaines d'entre elles avaient
conservé leurs chefs locaux et leurs conseillers missionnaires.
En 1888 cependant, les lles Sous-le-Vent furent à leur tour annexées par
la France, non sans quelques tentatives de rébellion, notamment à Huahine.
L'annexion des Gambier date de 1881, tandis que les Australes connurent le
même sort en 1900 et 1901.
Ainsi les cinq archipels tombèrent officiellement dans l'escarcelle des
Français et prirent le nom, en 1903, d'Établissements français d'Océanie (ÉFO).
Les bases du système colonial, jetées au courant du XIX'
siècle, s'affermirent au tournant du XX' siècle. A la veille de la
Première Guerre mondiale, l'économie était florissante. Les ÉFO
exportaient des produits locaux (vanille, coton, coprah, nacre et fruits)
en échange de biens manufacturés. À partir de 1911, l'exploitation des
richesses phosphatières de Makatea (Tuamotu) prend peu à peu le pas sur
les autres productions et assure des revenus substantiels à la colonie
jusqu'en 1966, date à laquelle le gisement est épuisé .
Cet essor économique et commercial exigeait une main-d'oeuvre de plus en
plus nombreuse, que la reprise démographique amorcée au début du siècle ne
permettait pas de fournir. Des colons, en majorité français,
s'implantèrent en Polynésie. En 1911, on comptait environ 3 500 Européens
dans les ÉFO. L'immigration chinoise, entamée en 1864
avec l'exploitation cotonnière à Atimaono, se poursuivit. En 1911, cette
communauté s'élèvait à plus de 1 000 personnes. En dépit de relations
parfois conflictuelles, ces trois communautés allaient progressivement se
mélanger suite à de multiples unions mixtes. Les bases d'une société
pluriethnique étaient en place.
Lors de la Première Guerre mondiale, près de 1
000 poilus tahitiens combattirent en Europe contre l'Allemagne. Le 22
septembre 1914, deux croiseurs allemands, en patrouille dans le Pacifique,
cherchèrent à se ravitailler dans le port de Papeete. Ils coulèrent le
navire français la Zélée et bombardèrent le quartier du marché de Papeete.
Les ÉFO s'illustrèrent une nouvelle fois lors de la Seconde Guerre
mondiale. Avec l'entrée en guerre des États-Unis en décembre 1941 suite à
l'attaque de Pearl Harbour, la Polynésie acquit un intérêt stratégique.
Afin de faire pièce à l'avancée japonaise dans le Pacifique, les
Américains se servirent de Bora Bora comme base de ravitaillement, en
accord avec les autorités de la France libre. Parallèlement, des jeunes
volontaires tahitiens et demis (métis), incorporés dans le bataillon du
Pacifique, luttèrent dès avril 1941 aux côtés des forces de la France
libre en Afrique du Nord, en Italie et en France.
En 1946, les ÉFO acquirent le statut de territoire d'outre-mer au sein de
la République française. Les prémices d'une volonté d'émancipation
vis-à-vis de la métropole se firent peu à peu jour. Mais en 1958. Le 'oui"
des Polynésiens au référendum de septembre portant sur le maintien de la
Polynésie dans la communauté française déstabilisa cette volonté.
Actuellement c'est le statut quo...
Pour aller
plus loin
ou
Wikipedia |