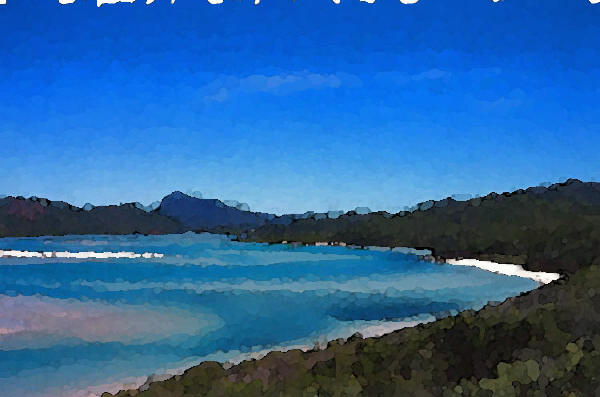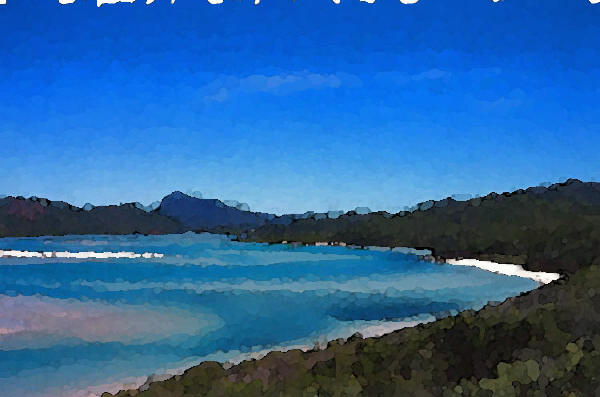| James Cook
Découverte de la
Nouvelle-Galles du Sud. Voyage le long de la côte de l'Australie ( 1770)
19 avril.
L'après-midi vent
frais du sud-sud-ouest par rafales. Temps couvert avec une forte houle du
sud. A une heure du matin nous mîmes à la cape et nous sondâmes sans trouver
de fond par cent trente brasses. A six heures nous vîmes terre, s'étendant
du nord-est à l'ouest, à cinq ou six lieues, par quatre-vingts brasses, fond
de sable fin. Nous continuâmes à porter ouest avec vent au sud-sud-ouest
jusqu'à huit heures, que nous forçâmes de voiles, et nous longeâmes la côte
nord-est en gouvernant sur la terre la plus orientale que nous vissions,
étant alors par 37° 58' de latitude sud et 210° 39' de longitude ouest. Je
jugeai que la pointe la plus méridionale de la terre qui nous restait à
l'ouest quart sud était située à 38° de latitude et 211° 7' de longitude par
rapport au méridien de Greenwich. Je l'ai appelée pointe Hicks parce que le
lieutenant Hicks fut le premier à la découvrir'. [ Il s'agit en fait du cap
à l'extremité Sud de la Tasmanie ]
(...) Ce que nous
avons vu de cette terre jusqu'à présent paraît bas, peu accidenté, l'aspect
du pays est vert et il y a beaucoup de bois, mais le bord de la mer est tout
en sable blanc.
28 avril.
Dans l'après-midi
nous mîmes à la mer, pour tâcher de débarquer, la pinasse et l'esquif, mais
la pinasse faisait eau à une telle vitesse qu'il fallut la remonter à bord
pour boucher les voies d'eau. A ce moment, nous vîmes sur le rivage
plusieurs habitants, dont quatre transportaient une petite embarcation que
nous supposions qu'ils allaient mettre à l'eau pour venir vers nous, mais
nous nous trompions. N'étant pas alors à plus de deux milles de la côte,
monsieur Banks, le docteur Solander, Toupia et moi nous embarquâmes sur
l'esquif, et nous voguâmes vers la terre, à un endroit où nous voyions
quatre ou cinq naturels qui s'enfuirent vers le bois quand nous approchâmes
du rivage. Ce fut unedéception, car nous espérions pouvoir au moins les voir
de près, si nous ne pouvions leur parler. Mais nous fûmes encore plus déçus
quand nous vîmes que nous ne pouvions débarquer nulle part à cause de la
grosse houle qui brisait partout sur le rivage.(...)
29 avril.
Dans
l'après-midi, vents du sud et temps clair, avec lequel nous continuâmes à
porter sur la baie, et nous jetâmes l'ancre au-dessous de la côte sud, à
deux milles de l'entrée, dans cinq brasses, la pointe sud nous restant au
sud-est et la pointe nord à l'est. En avançant,nous découvrîmes sur les deux
pointes de la baie plusieurs naturels du pays et quelques huttes ; des
hommes, des femmes et des enfants, sur la rive sud, en face du navire ; je
m'y rendis avec les canots, accompagné de monsieur Banks, du docteur
Solander et de Toupia. Comme nous approchions du rivage, ils s'enfuirent
tous, excepté deux hommes qui semblaient décidés à nous empêcher de
débarquer. Aussitôt que je m'en aperçus, je donnai l'ordre de cesser de
ramer afin de leur parler, car ni nous ni Toupia ne comprenions un mot de ce
qu'ils disaient. Nous leur jetâmes quelques clous, verroteries, etc., qu'ils
ramassèrent, et qui semblèrent ne pas leur déplaire, si bien que je crus
qu'ils nous faisaient signe de débarquer ; mais je me trompais, car aussitôt
que le bateau s'approcha ils s'avancèrent pour essayer de l'en empêcher, sur
quoi je fis tirer un coup de fusil entre eux deux, ce qui n'eut d'autre
effet que de les faire reculer jusqu'à un endroit où ils avaient des paquets
de javelines, et l'un d'eux prit une pierre et nous la jeta. Je fis tirer
une deuxième fois avec du menu plomb ; cela n'eut pas d'autre effet que lui
faire saisir un bouclier. Tout de suite après nous débarquâmes ; ce ne fut
pas plus tôt fait qu'ils nous décochèrent deux javelines, ce qui m'obligea à
faire feu une troisième fois, et bientôt après ils se retirèrent, mais pas
tellement vite que nous n'eussions pu nous saisir de l'un d'eux. Mais
monsieur Banks était d'avis que les javelines étaient empoisonnées, et je
jugeai plus prudent de ne pas nous hasarder dans les bois. Nous trouvâmes là
quelques petites huttes en écorce, dans une desquelles il y avait quatre ou
cinq petits enfants, auxquels nous laissâmes quelques verroteries, etc. Il y
avait trois canots sur la plage, les plus mal travaillés que j'eusse jamais
vus ; ils étaient longs d'environ douze ou quatorze pieds, faits d'un seul
morceau d'écorce serrée et attachée à chaque bout, et le milieu maintenu
ouvert au moyen de bâtons en guise de traverses. Après avoir cherché de
l'eau douce sans succès, excepté dans un petit trou creusé dans le sable,
nous nous embarquâmes et traversâmes jusqu'à la pointe nord de la baie, où
nous vîmes, en y entrant, plusieurs habitants, mais quand nous allâmes à
terre il n'y avait plus personne. Là, nous trouvâmes un peu d'eau douce, qui
ruisselait sur les rochers et y formait de petites mares ; mais, comme on ne
pouvait l'atteindre sans peine, j'envoyai à terre le lendemain matin un
détachement de matelots à l'endroit de la côte où nous avions débarqué, pour
y creuser des trous dans le sable ; ils eurent par ce moyen, en y ajoutant
celle d'un petit ruisseau qu'ils rencontrèrent, assez d'eau pour le navire.
Les colliers de verroterie, etc., que nous avions laissés aux enfants
étaient encore dans les huttes le lendemain matin ; les naturels n'avaient
probablement pas osé les emporter. Après le déjeuner, nous envoyâmes à terre
quelques futailles vides et des matelots pour couper du bois ; je partis
moi-même dans la pinasse pour visiter la baie, et je vis quelques naturels,
mais ils s'enfuirent tous à mon approche. Je débarquai en deux endroits, ils
venaient juste de quitter l'un d'entre eux, car il y avait de petits feux
sur lesquels grillaient des moules fraîches. Il y avait aussi des coquilles
d'huîtres, les plus grandes que j'eusse jamais vues.
1 mai.
Brises légères du
nord. Dans l'après-midi, dix naturels retournèrent au lieu de l'aiguade.
Etant à bord à ce moment-là, je me rendis immédiatement à terre, mais quand
ils consentirent à s'arrêter ils étaient trop loin pour que je pusse me
hasarder à les suivre. Ils étaient armés de la même manière que ceux qui
étaient venus la veille. Dans la soirée, j'envoyai quelques hommes pour
jeter la seine, mais ils ne prirent que très peu de poisson. Un peu après le
lever du soleil, je trouvai la variation de 11° 3' est. Hier soir, le
matelot Forby Sutherland passa de vie à trépas, et le matin son corps fut
enterré près du lieu de l'aiguade. et je donnai son nom à la pointe
méridionale de la baie. Ce matin, nous fûmes quelques-uns à aller à terre
visiter, non loin du lieu de l'aiguade, des huttes où quelques naturels
continuaient d'aller tous les jours. Nous y laissâmes divers objets tels que
miroirs, peignes, clous, verroteries, et de l'étoffe. Après cela nous fîmes
une excursion dans le pays, dont l'aspect est diversifié par des bois, des
prés, des marécages. Dans les bois, rien ne pousse sous les arbres; et
ceux-ci sont si espacés que l'on pourrait cultiver tout ou presque tout le
pays sans abattre un seul arbre. Nous trouvâmes que le sol était partout,
sauf dans les marécages, d'un sable blanc et léger, recouvert d'une bonne
herbe qui croît par
petites touffes serrées les unes contre les autres, qu'on peut tenir à
poignées. Dans les bois, entre les arbres, le docteur Solander aperçut de
loin un petit animal qui ressemblait à un lapin, et nous trouvâmes la fiente
d'un animal qui doit se nourrir d'herbe et qui ne doit pas être plus gros
qu'un daim [il s'agit d'un Kangourou] ; nous vîmes aussi les traces d'un
chien [ un dingo], ou autre animal de cette sorte. Nous trouvâmes quelques
huttes, et des emplacements où l'on voyait des traces du passage de
naturels. En arrivant nous en vîmes un, les autres avaient dû fuir à notre
approche. Il y avait quelques arbres, qui avaient été abattus par des
naturels avec un outil grossier, et plusieurs dont l'écorce avait été
détachée avec le même outil'.
Les naturels
ne semblent pas être nombreux, ni vivre en société, mais dispersés par
petites bandes le long de la côte, au bord de l'eau. Ceux que je vis étaient
à peu près de la taille des Européens, d'un brun très foncé,
mais pas noirs, et leurs cheveux n'étaient ni laineux ni crépus, mais lisses
et plats comme les nôtres et de couleur noire. Personne parmi nous n'en vit
jamais un seul
qui eût le moindre vêtement ; et ils ne portaient pas d'ornements, pas plus
qu'ils n'en mettaient sur leurs
huttes. Quelques-uns de ceux que nous vîmes avaient le visage et le corps
colorés avec une sorte de peinture
ou de teinture blanche. J'ai dit que les coquillages faisaient le fond de
leur nourriture, mais ils pêchent aussi
d'autres sortes de poissons, dont nous trouvâmes quelques-uns qui grillaient
sur le feu la première fois que nous étions allés à terre. Ils prennent
certaines
espèces en les harponnant avec un trident, d'autres avec la ligne et
l'hameçon ; nous les avons vus harponner des
poissons, et nous avons trouvé des hameçons et des lignes dans leurs huttes.
Je ne crois pas qu'ils mangent des pastenades, car je n'en ai jamais vu le
moindre débris près de leurs huttes ou de leurs foyers. Mais nous ne
pûmes apprendre que fort peu de choses sur leurs moeurs, puisque nous ne
réussîmes pas à entrer en relations avec eux. Ils n'avaient même pas touché
les objets que nous avions laissés dans leurs huttes, espérant qu'ils les
emporteraient. Pendant que nous étions dans ce havre, je fis tous les jours
arborer les couleurs anglaises à terre, et je fis graver sur un arbre près
du lieu de l'aiguade le nom du navire, la date, etc. Ayant pris connaissance
de toutes les ressources de l'endroit, le lendemain matin dès le jour, nous
levâmes l'ancre et mîmes en mer, avec une brise légère du nord-ouest.
Celle-ci bientôt après sauta au sud, et nous rangeâmes la côte
nord-nord-ouest. (...)
23 mai.
La nuit
dernière, pendant la garde du milieu de la nuit, une aventure très
singulière arriva à mon secrétaire, monsieur Orton. Comme il avait bu avec
excès pendant la soirée, un ou plusieurs malicieux passagers du navire
profitèrent de son état d'ivresse pour couper et ôter de sur son dos tous
ses vêtements ; et, non contents de cela, ils vinrent un peu après dans sa
cabine et lui coupèrent un morceau de chaque oreille pendant qu'il reposait
endormi dans son lit. Ses soupçons se portèrent sur monsieur Magra, un des
midshipmen, mais je n'en voyais pas la raison. Cependant, en faisant mon
enquête, j'appris que Magra avait déjà une ou deux fois coupé ses habits,
pendant qu'ils se livraient à leurs amusements d'ivrognes, et disait que si
ce n'était pas défendu par les lois il le tuerait ; j'en vins donc à penser
que Magra n'était pas entièrement innocent. Aussi je lui interdis
momentanément le gaillard d'arrière et le suspendis de toutes ses fonctions,
car ce monsieur était de ceux que l'on se passerait aisément de trouver à
bord des navires de Sa Majesté, où il y en a trop souvent de cette sorte. De
plus, il fallait que ma désapprobation se montrât tout de suite et
s'adressât à la personne soupçonnée, de crainte que l'on n'en restât pas là.
Quant à monsieur Orton, il n'est pas sans défauts ; cependant, de tous les
témoignages que je réunis, il ressortait avec évidence que, loin de mériter
de tels traitements, il n'avait envers personne d'intentions offensantes, ce
qui fait que je le regarde, et le regarderai toujours, comme l'offensé. On
pourrait cependant alléguer des raisons qui explique. raient sa mésaventure,
et desquelles il faudrait conclure qu'il mériterait aussi quelque blâme.
Mais là-dessus j'en suis réduit à des suppositions ; et elles impliqueraient
dans cette affaire quelques personnes que j'aurais de la peine à croire
capables d'un tel méfait. Je n'en dirai donc rien, à moins que, par la
suite, je ne découvre les coupables, ce à quoi j'emploierai tous les moyens
dont je dispose ; je considère en effet de tels procédés comme
essentiellement dangereux pendant un voyage comme le nôtre : ils
représentent la plus grande insulte que l'on puisse faire à mon autorité sur
ce navire, puisque je suis toujours prêt à écouter les plaintes contre qui
que ce soit à bord du navire, et à y faire droit s'il y a lieu'.
11 juin.
Mon
intention était de rester au large toute la nuit, autant pour éviter le
danger qui se présentait devant nous que pour voir s'il y avait des îles
dans l'ouverture, surtout comme nous commencions à approcher de la latitude
de celles que Quiros a découvertes, et que quelques géographes, je ne sais
pour quelle raison, ont jugé à propos d'adjoindre à cette terre. Favorisés
par un bon vent et une nuit de clair de lune, en portant au large de six
heures à neuf heures, la profondeur de notre eau passa de quatorze à vingt
et une brasses, mais retomba tout à coup à douze, dix et huit. J'ordonnai
sur-le-champ à chacun de se rendre à son poste pour virer de bord et mettre
à l'ancre. Mais ce ne fut pas une heureuse décision, car, me retrouvant en
eau profonde, je crus qu'il n'y avait plus de danger. Avant dix heures, nous
avions vingt et vingt et une brasses, et continuâmes dans ce fond jusque
quelques minutes avant onze heures ; nous avions alors dix-sept et avant que
l'homme chargé de la sonde ait pu la jeter de nouveau le vaisseau heurta le
récif et se fixa solidement'. Nous abattîmes immédiatement toutes les
voiles, et les chaloupes furent mises en mer pour sonder autour du vaisseau
; nous trouvâmes qu'il avait porté sur le bord sud-est d'un banc de corail ;
aux alentours nous avions par endroits trois ou quatre brasses d'eau, mais
ailleurs la profondeur n'était même pas de trois ou quatre pieds ; et à
environ une longueur de bâtiment de nous à tribord, l'avant étant au
nord-est, il y avait huit, dix ou douze brasses.
Dès que la chaloupe fut en mer, nous jetâmes l'ancre à tribord, nous mîmes
l'ancre d'affourche avec son câble dans le bateau, et on allait la jeter du
même côté ; mais, quand je sondai pour la deuxième fois du même côté, je
trouvai l'eau plus profonde à l'arrière. Nous portâmes donc cette ancre à la
poupe et nous travaillâmes de
[
En remontant la côte du Queensland, Cook ignorait qu'il naviguait en dedans
des récifs de la Grande Barrière, qui convergent vers le rivage dans le
voisinage de Cooktown. L'épisode de beaucoup le plus dangereux du voyage
survint quand l'Endeavour heurta le bord intérieur de cette formation
corallienne à l'endroit actuellement appelé le récif de l'Endeavour. Ce qui
aggrava la situation, qui fut bien près d'être désespérée, fut que x la
marée était à son plus haut point iD quand le vaisseau s'échoua, et que le
port le plus rapproché pour les réparations était Batavia, éloigné de quinze
cents milles.
Deux ans
auparavant, Bougainville avait touché la bordure extérieure lorsqu'il
s'approcha, venant de l'est à la recherche du détroit de Torres. C'est ce
qui l'empêcha de découvrir la côte est de l'Australie, car il prit alors sa
route vers Java en faisant le tour de la Nouvelle-Guinée. Si Cook avait eu
connaissance des cartes de Dieppe, il aurait vu que cette partie est marquée
« coste dangereuses. Il semble avoir été guidé par un sens instinctif du
danger, puisqu'il faisait de fréquents sondages .n.d.l.r.]
toutes nos forces
au cabestan, mais en vain, le vaisseau étant tout à fait fixé ; ce que
voyant nous nous mîmes à l'alléger le plus vite possible. Comme nous étions
échoués au plus fort de la marée haute, non seulement nous commençâmes à
vider de l'eau, mais nous jetâmes par-dessus bord nos canons, du lest de fer
et de pierre, des futailles, des douves et des cerceaux, des jarres d'huile,
des provisions avariées, etc. Beaucoup de ces objets empêchaient d'en
atteindre de plus lourds. Pendant tout ce temps le bateau ne faisait eau que
peu, ou pas du tout. A onze heures, jugeant que la marée était haute, nous
essayâmes de remettre le navire à flot, mais sans succès, il ne flottait pas
de plus d'un pied et demi, quoique ce que nous avions jeté par-dessus bord
l'eût allégé d'environ quarante à cinquante tonneaux. Voyant que ce n'était
pas suffisant, nous continuâmes de l'alléger par tous les moyens que nous
pûmes imaginer. A mesure que la marée descendait, l'eau se mit à entrer à
une telle vitesse que deux pompes suffisaient à peine à le vider.(...)
[ finalement
l'équipage après bien des manœuvres arrivera à se sortir du récif]
4 août.
Comme vivres
frais, il v avait surtout des tortues ; mais il fallait aller les chercher à
cinq lieues en mer et le vent nous en empêcha souvent, de sorte que nous
n'eûmes pas surabondance de cet animal, mais comme nous prenions aussi du
poisson avec la seine nous n'eûmes pas sujet de nous plaindre, si l'on
considère le pays où nous nous trouvions. Quelque denrée que nous eussions à
partager, je la faisais répartir entre tous les membres de l'équipage sans
exception, en général par poids égaux. Quel que fût l'importance ou le rang,
tout le monde avait une part égale à la mienne ; et c'est une règle que le
commandant d'un navire devrait toujours observer au cours d'un voyage de
cette sorte. Sur les plages ou dans les dunes de sable, nous trouvâmes du
pourpier ; bouilli, il fut très apprécié ; ainsi qu'une sorte de fève qui
pousse sur une tige rampante qui ressemble à la vigne, et qui fut, surtout
au début, d'un grand secours pour les malades. Mais les meilleurs herbages
que nous trouvâmes étaient la tarra, ou pointes de coco, que, dans les Indes
orientales, on appelle chou caraïbe ; il croît dans la plupart des endroits
marécageux, et il est aussi mangeable et même meilleur que les épinards. Les
racines, faute d'avoir été transplantées et cultivées, n'étaient pas bonnes.
Nous eussions cependant pu nous en accommoder si nous en avions eu en assez
grande quantité, mais il fallait aller chercher trop loin,
et cela occupait un trop grand nombre d'hommes de ramasser les feuilles et
les racines. Les quelques choux
palmistes que nous trouvâmes étaient en général petits et produisaient si
peu de choux que ce n'était pas la
peine de les chercher, et il en était de même pour la plupart des fruits,
etc., que l'on trouvait dans les bois.
A part l'animal dont j'ai déjà parlé, que les naturels nomment kangourou, il
y a ici des loups ", des opossums - animal qui ressemble au rat-, des
serpents venimeux,
et d'autres inoffensifs. Il n'y a pas d'animaux domestiques, excepté des
chiens, et encore n'en vîmes-nous qu'un seul, qui venait souvent autour de
nos tentes, en quête d'os, etc. Les kangourous sont les plus répandus de
tous ces animaux ; nous allions rarement dans les terres sans en voir
plusieurs. Les volatiles de terre sont
peu nombreux ; ce sont des corneilles, des milans, des éperviers, des
cacatois de deux espèces, l'une blanche, l'autre brune, de très beaux
loriots de deux ou trois sortes, des pigeons, des ramiers et quelques autres
petits oiseaux. Les oiseaux ou volatiles aquatiques ou marins sont des
hérons, des canards siffleurs qui perchent et, je crois, nichent sur des
arbres, des courlis, etc., tous assez nombreux. Quelques-uns de nos
messieurs, qui se trouvèrent à terre de nuit, y virent et y entendirent des
oies sauvages.
Le pays, autant que j'aie pu en juger, est varié. Il y a des parties élevées
et des plaines, et celles-ci sont entrecoupées de bois et de prairies. Le
sol des collines est dur, sec, très pierreux ; il produit pourtant une herbe
fine et rude, et quelques bois. Le sol des plaines et des vallées est
sablonneux, ou argileux par places, et en bien des endroits très rocheux et
pierreux comme les collines. Mais en général la terre porte une bonne
couverture d'herbe haute, ou des taillis et des bois. Dans tout le pays, les
fourmilières pullulent, il y en a qui ont jusqu'à six à huit pieds de haut,
et deux fois autant de circonférence. Il y a peu d'autres espèces d'arbres
que le gommier, très abondant, et que nous avions aussi rencontré sur la
partie méridionale de la côte, mais ici il ne devient pas à beaucoup près
aussi grand. Sur tout le cours de la rivière, il y a de chaque côté des
manguiers, qui par endroits s'en éloignent jusqu'à près d'un mille. Le pays
est assez bien irrigué, car il y a plusieurs jolies petites rivières, à peu
de distance les unes des autres, mais aucune près de l'emplacement que nous
avions choisi, en tout cas pendant la saison sèche, dans laquelle nous
sommes. Cependant nous étions très bien approvisionnés en eau par des
sources qui n'étaient pas fort éloignées.
7 août.
Après avoir bien
examiné notre position du haut de la grande hune, je vis que de toutes parts
nous étions environnés de dangers ( récifs) ; si bien que je ne savais pas
du tout de quel côté gouverner quand le temps permettrait de mettre à la
voile (...)
16 août.
Nous n'avions pas
couru plus de deux milles au sud-sud-est que nous eûmes calme plat. Nous
sondâmes, ce que nous avions déjà fait plusieurs fois, mais ne trouvâmes pas
le fond par cent quarante brasses de ligne. Un peu après quatre heures, le
mugissement de la houle se fit entendre sans doute possible, et au jour
l'immense écume des lames n'était que trop visible, à moins d'un mille de
nous, le vaisseau étant porté vers elle par les vagues avec une étonnante
rapidité. Nous n'avions à ce moment pas un souffle de vent, et la profondeur
de l'eau était insondable, de sorte qu'il n'y avait aucune possibilité de
jeter l'ancre. Dans cette détresse, nous n'avions d'autre recours que la
Providence, et l'aide médiocre que les chaloupes pouvaient nous fournir ; la
pinasse était en radoub et ne pouvait être mise en mer sur-le-champ. On mit
à l'eau la chaloupe et l'esquif et on les envoya en avant pour nous
remorquer, ce qui permit de mettre le cap du navire au nord ; cela
paraissait être le meilleur moyen de le maintenir à l'écart du banc, ou en
tout cas de gagner du temps. Avant que ce fût fait il était six heures et
nous n'étions pas à plus de quatre-vingts ou cent yards des brisants. La
même eau qui battait les côtés du navire brisait à une hauteur prodigieuse
au moment où elle montait, de sorte qu'entre nous et la destruction il n'y
avait qu'une épouvantable vallée d'eau, de la largeur de la base d'une
vague, et on ne trouvait pas le fond avec cent vingt brasses. A Ce moment la
pinasse étant remise en état, je la fis mettre en mer et l'envoyai à l'avant
pour nous touer ; malgré quoi nous n'avions guère d'espoir de sauver ni
notre
bâtiment ni nos vies, car nous étions à dix bonnes lieues de la terre la
plus proche. et les chaloupes ne pouvaient suffire à nous porter tous.
Cependant, dans cette situation vraiment terrible, pas un seul des hommes ne
cessa de faire tout son possible, et cela avec autant de calme que si aucun
danger ne nous avait menacés". Tous les dangers auxquels nous avions échappé
étaient peu de chose en comparaison de celui auquel nous étions exposés,
d'être jetés contre ce banc, sur lequel le bâtiment devait fatalement être
brisé et voler en éclats en une minute. On ne sait pour ainsi dire pas en
Europe ce qu'est un banc tel que celui dont il s'agit : c'est une muraille
de rochers de corail, qui s'élève presque perpendiculairement de l'océan
insondable ; ces rochers sont toujours couverts à la haute mer, et secs par
places quand la marée baisse. Les grandes vagues du vaste océan rencontrant
cette soudaine résistance forment une redoutable houle dont les lames au
moment de se briser sont hautes comme des montagnes, plus que jamais quand
les vents alizés leur soufflent directement dessus, comme c'était le cas.
En cette extrémité, alors que tous nos efforts se montraient vains, un
souffle d'air s'éleva, mais si faible que, s'il se fût produit dans un
calme, en toute autre occasion nous ne l'aurions pas remarqué. Grâce à lui,
et à l'aide de nos canots, le navire commença à s'écarter obliquement des
récifs, mais au bout de moins de dix minutes le calme revint aussi plat que
jamais et nos craintes se renouvelèrent, car nous n'étions pas à plus de
deux cents yards des brisants.(...)
Description sommaire de la
Nouvelle-Galles du Sud
Au cours de ce journal, j'ai déjà rapporté plusieurs particularités
concernant l'aspect que présente ce pays, la nature du sol et ses produits,
etc. Il faut faire remarquer en premier lieu qu'au sud de 33 ou 34° les
terres sont en général basses et unies, et il y a très peu d'élévations de
terrain.
Plus au nord, on peut dire qu'elles sont par endroits montagneuses, car,
mises ensemble, les collines et les montagnes n'occupent qu'une faible part
de la surface vallonnée, mais il n'y a guère de régions où elles soient en
comparaison des plaines et des vallées qui les séparent. Elles sont partout
bien arrosées, même dans la saison sèche, par de petits ruisseaux et des
sources, mais il n'y a pas de grandes rivières, sauf dans la saison des
pluies ; je suppose en effet que les plaines et les vallées
proches de la mer sont alors en grande partie sous l'eau. Il se peut que les
petits ruisseaux se transforment alors en grandes rivières, mais seulement
sous les tropiques. L'eau ne nous manqua que dans le canal de la Soif, mais
cela tenait à ce que le pays est très découpé en criques salées, et qu'il y
a beaucoup de terres à palétuviers.
Près de la mer, et même aussi loin dans les terres que nous ayons pénétré,
le sol des plaines est le plus souvent friable, mou et sablonneux. Mais
toutes ces plaines sont couvertes de buissons et de plantes. Les terres
élevées sont entrecoupées de prairies, quelques-unes des collines sont
entièrement couvertes d'arbres en fleurs ; sur d'autres, ils sont espacés,
et les quelques-uns qui y croissent sont petits, et à la place de prairies
ou de savanes il y a des terrains rocheux et dénudés, en particulier au
nord, où la végétation est loin d'égaler celle que produisent les régions
méridionales, les arbres dans les bois sont moitié moins hauts et moins
gros. Les bois ne produisent pas une grande variété d'arbres, il y en a
seulement deux ou trois sortes que l'on puisse considérer comme bois de
construction. Le plus grand est le gommier (ou eucalyptus) qui croît partout
dans ce pays. Le bois de cet arbre est trop dur et trop lourd pour la
plupart des usages courants. Je n'ai vu arriver à sa perfection l'arbre qui
ressemble à nos pins que dans la baie de la Botanique. La qualité de son
bois rappelle, comme je l'ai déjà fait remarquer, celle du chêne-vert
d'Amérique. En bref beaucoup de grands arbres de ce pays ont un bois dur et
lourd, et il n'y a qu'un petit nombre d'usages à en faire. On trouve aussi
plusieurs sortes de palmiers, de manguiers, et d'autres espèces de petits
arbres ou d'arbustes qui me sont inconnus ; et de plus un grand nombre de
plantes qui l'étaient aussi jusqu'ici, mais leur description n'est pas de
mon domaine, et l'on n'y perdra rien, puisque monsieur Banks et le docteur
Solander décriront avec beaucoup de précision non seulement les plantes,
mais tout ce qui peut être de quelque importance pour le monde savant. La
terre ne fournit presque aucun produit naturel mangeable, et les naturels
gnorent toute culture. Il y a pourtant quelques espèces de fruits sauvages
dans les bois, la plupart inconnus de nous, qui ne sont pas mauvais au goût
quand ils sont mûrs ; en particulier une espèce que nous appelions pomme
parce qu'il est à peu près de la grosseur d'une pomme sauvage : il est noir
et charnu quand il est mûr, et son goût ressemble à celui des prunes de
Damas ; son noyau est gros et dur, et il est porté par de petits arbres ou
arbustes.
Les naturels de ce pays sont de taille moyenne, leur corps est droit et
leurs membres minces. Leur peau est de la couleur de la suie de bois ; leur
cheveux sont le plus souvent noirs, et ils les portent toujours coupés
courts. Les hommes ont la barbe noire et en général se la coupent, ou la
raccourcissent en la brûlant. Ils ont des traits agréables et leur voix est
douce et harmonieuse. Hommes et femmes vivent complètement nus, sans jamais
le moindre vêtement d'aucune sorte ; bien que personne parmi nous ne se soit
jamais trouvé très près d'aucune de leurs femmes, excepté un de nos
messieurs, nous pouvons en être aussi sûrs que si nous avions vécu parmi eux
; nous eûmes en effet plusieurs entrevues avec les hommes pendant que nous
étions sur la rivière Endeavour, mais, fut-ce jalousie ou dédain ? ils
n'amenèrent jamais aucune de leurs femmes au navire, et les laissaient sur
l'autre bord de la rivière, où nous eûmes de nombreuses occasions de les
regarder avec nos longues-vues. Comme ornements ils portent des colliers de
coquillages, des cercles qui servent de bracelets autour du bras, et qu'ils
font avec des cheveux entrelacés et travaillés comme un anneau de corde ;
ces bracelets sont placés au haut du bras et le serrent étroitement ; on
fait aussi des ceintures de même sorte. Les hommes portent, passé à travers
la paroi du nez, un os long de trois ou quatre pouces et épais d'un doigt.
Ils ont aussi les oreilles percées pour y mettre des pendants d'oreilles,
mais nous n'en avons pas vu sur eux. Les autres ornements ne sont d'ailleurs
pas non plus d'usage courant, les uns en portent, les autres non.
Quelques-uns de ceux que nous vîmes sur l'île de la Possession portaient des
plaques de poitrine, que nous supposâmes être faites de coquilles de nacre.
Beaucoup d'entre eux se peignent le corps avec une espèce de pâte de couleur
blanche, qu'ils appliquent de diverses manières, chacun suivant sa
fantaisie.
Leurs armes de combat sont des piques et des javelines ; il y en a dont
l'extrémité est effilée, d'autres sont barbelées avec du bois, des dents de
requins ou des arêtes de gros poissons. Celles-ci sont enduites d'une gomme
qui les fait pénétrer plus profondément. Ils lancent les javelines d'une
seule main, et se servent pour cela d'un morceau de bois long d'environ
trois pieds, que l'on a aminci jusqu'à être comme la lame d'un coutelas, et
muni d'un petit crochet à l'un de ses bouts, où l'on passe l'extrémité de la
javeline, tandis qu'à l'autre bout est fixé un morceau d'os long de trois ou
quatre pouces je pense que celui-ci sert à maintenir le trait et à assurer
sa direction au moment où il quitte la main. Avec ces instruments que nous
appelions bâtons à lancer, ils touchent un but à quarante ou soixante yards
avec presque autant de précision que nous ferions avec un mousquet, et
beaucoup plus qu'avec un fusil à balle. Nous avions d'abord pris ces «
bâtons-lanceurs » pour des sabres de bois, et il se peut qu'en quelques
occasions on en fasse cet usage, par exemple quand la provision de javelines
est épuisée. Quoi qu'il en soit, ils ne se déplacent jamais sans les
emporter, ainsi que leurs piques, non par crainte de leurs ennemis, mais
pour tuer du gibier, etc., comme je le montrerai ci-après. Comme armes
défensives, ils ont des boucliers en bois, mais nous ne les vîmes jamais
s'en servir, sauf une fois, dans la baie de la Botanique.
On ne peut pas regarder ces naturels comme un peuple guerrier, je les
considère au contraire comme une race inoffensive et craintive, nullement
portée à la cruauté, ainsi qu'en témoigne leur conduite envers un de nos
hommes, dans la rivière Endeavour, dont j'ai déjà parlé ; ils ne sont pas
non plus très nombreux. Ils vivent par petits groupes le long de la côte, ou
sur les rives des lacs, des rivières, des criques, etc. Es ne semblent pas
avoir d'habitations fixes, mais se transportent d'endroit en endroit, comme
des bêtes sauvages à la recherche de nourriture, et ne s'assurent leur
subsistance qu'au jour le jour, suivant ce qu'ils rencontrent. Ils ont des
harpons de bois, à deux, trois ou quatre fourchons, très ingénieusement
faits, avec lesquels ils piquent le poisson. Nous les avons aussi vus
toucher des poissons et des oiseaux avec leurs javelines, dont ils se
servent aussi bien pour tuer d'autres animaux. Ils ont aussi des harpons
pour piquer des tortues, mais je ne crois pas qu'ils en prennent beaucoup,
excepté à la saison où elles viennent à terre pour pondre. Bref, ces peuples
vivent principalement de chasse et de pêche, mais surtout de cette dernière.
Sur toute la surface de leur pays, nous n'avons vu nulle part un pouce de
terre cultivée. Ils savent cependant que l'on peut manger les taara, et en
mangent quelquefois. Nous ne leur avons jamais vu manger quoi que ce soit de
cru, ils font rôtir ou griller tout ce qu'ils mangent sur de petits feux
lents. Leurs maisons sont de misérables petits abris guère plus grands qu'un
four, faits de branches, d'écorce, d'herbe, etc. ; encore ne s'en servent
ils que pendant la saison humide, car pendant la journée c'est en plein air
qu'on les voit le plus souvent dormir. Nous avons vu bien des endroits où
ils couchent, abrités par des écorces, de l'herbe, s'élevant d'un pied à
peine du côté d'où venait le vent.
On ne peut rien imaginer de plus misérable que leurs embarcations, en
particulier dans la partie méridionale du pays, où toutes celles que nous
vîmes se composaient d'un seul morceau d'écorce, de douze à quatorze pieds
de long, serré et attaché à l'un de ses bouts. Comme je l'ai déjà dit, ces
pirogues ne peuvent porter plus de deux personnes, et il n'y en a
généralement qu'une dans chacune. Mais telles qu'elles sont elles
conviennent très bien pour l'emploi qu'ils en font, et même mieux que si
elles étaient plus grandes, car comme elles n'ont qu'un petit tirant d'eau
on s'en sert pour aller sur les fonds vaseux, et on peut récolter des
coquillages, etc., sans en sortir. Les quelques embarcations que nous avons
vues plus au nord étaient faites d'une pièce de bois creusée,longue
d'environ quatorze pieds et très étroite, et
avaient un balancier. Celles-là pouvaient porter quatre personnes. Pendant
tout notre séjour sur la rivière Endeavour, nous ne vîmes qu'une pirogue, et
tout portait à croire que les quelques habitants de ces parages n'en avaient
pas d'autre. Elle leur servait à traverser la rivière, à aller à la pêche,
etc. Les naturels surveillent les hauts et les bas-fonds, de-ci de-là, tous
les jours à marée basse, pour ramasser des coquillages, ou toute autre chose
à manger ; ils ont chacun un petit sac pour y mettre ce qu'ils trouvent, ce
sac est en filet. Ils n'ont absolument aucune connaissance du fer, ni
d'aucun autre des métaux dont nous nous servons ; il est probable que leurs
outils sont en os, en pierre ou en coquilles. Ces dernières, à en juger
d'après une herminette que je vis, fournissent de très mauvais outils.
Si médiocres que soient leurs embarcations, ils s'en servent à certaines
saisons pour aller aux plus éloignées des îles qui bordent la côte ; en
effet, dans toutes celles où nous débarquâmes, on voyait à divers signes que
des hommes y avaient été avant nous. Si nous n'avions pas trouvé de maisons,
etc., sur l'île Lizard, située à cinq lieues des terres, nous n'eussions pas
cru possible que leurs canots puissent les y porter.
Les côtes de ce pays, au moins tout ce qui est au nord du vingt-cinquième
degré de latitude, sont creusées de nombreux havres et baies favorables qui
sont abrités de tous les vents, mais le pays lui-même ne produit, à notre
connaissance, rien qui puisse devenir un objet de commerce et attirer des
établissements d'Européens. Néanmoins, ce côté est n'est pas, comme la côte
ouest que Dampier a décrite, une contrée stérile et déshéritée. Il faut se
rappeler que nous voyons ce pays à l'état de nature ; aucune de ses parties
n'a jamais été touchée par l'industrie des hommes, et cependant on y trouve
dans un état prospère toutes les choses dont la nature l'a pourvu. Sans
aucun doute la plupart des graines, fruits, racines, etc., de toutes sortes
y prospéreraient si on les Y transportait, et qu'elles y fussent plantées et
cultivées par des mains expertes ; et il y aurait de la provende,en toutes
saisons de l'année, pour plus de bétail qu'on ne pourrait y en amener.
Ce que j'ai dit des naturels de la Nouvelle-Hollande pourrait faire croire
que ce peuple est le plus misérable qui existe ; mais en réalité ils sont
beaucoup plus heureux que nous Européens, étant totalement ignorants non
seulement du superflu, mais aussi des commodités nécessaires tellement
recherchées en Europe. Il est heureux pour eux de ne pas en connaître
l'usage. Ils vivent dans une tranquillité que ne trouble pas l'inégalité des
conditions. De leur propre aveu, la terre et la mer leur fournissent toutes
les choses nécessaires à la vie. Ils ne convoitent pas des maisons
magnifiques pourvues de nombreux serviteurs. Ils vivent dans un climat beau
et chaud, et profitent de tous les bienfaisants souffles qui agitent l'air,
de sorte qu'ils n'éprouvent pas le besoin d'avoir des vêtements : quand nous
leur en donnâmes, ils les abandonnèrent négligemment dans les bois ou sur
les plages, comme s'ils ne savaient absolument pas qu'en faire : en bref,
ils ne semblèrent attacher de prix à rien de ce que nous leur donnions, et
ne voulurent se séparer de rien de ce qu'ils possédaient en échange de
n'importe lequel des objets que nous pouvions leur offrir, ce qui prouve à
mon avis qu'ils se considèrent comme pourvus de tout ce qui est nécessaire
pour vivre, et qu'ils n'ont aucun superflu.(...)
Extraits de James Cook Relations de
voyages autour du monde Editions de la découverte
|