

Dans le premier monde, celui des origines ou celui de leur
histoire selon les wayana la fluidité des formes est le thème exclusif
Il faut se représenter un univers aux contours indéfinis, aux formes
changeantes :
« tout pouvait se transformer en tout », affirment ils.
Non pas un univers amorphe, mais un monde caractérisé par un polymorphisme total et
permanent.
Cette période des débuts est celle de la toute puissance du désir, du rêve
...
Kuyuli a-t-il besoin d'un oiseau pour surveiller sa nasse, et les oiseaux
sont créés"'...
L'irruption de l'histoire, au sens occidental du terme, dans le monde du « mythe
» correspond au retrait de cette capacité magique du vivant : la métamorphose,
anuktatop
C'est alors que survient la grande césure qui allait instaurer le règne de la
matière intransformable : cette césure résulte du fait que les hommes ont
humilié le démiurge, débouchant sur un événement majeur : l'inondation,
l'élimination des premiers humains, le feu gigantesque..
...et l'humiliation est causée par l'adultère qui bien que très
fréquent chez eux, constitue pour les Wayana La faute.
Il représente, surtout quand il est exposé, la réalisation la plus aboutie
du non respect des convenances, du mépris de la règle ;
il est la principale
source de conflits, de tensions.
Presque tous les récits de la tradition tournent autour de ce thème et
mettent en exergue le regret profond, le réel chagrin qu'éprouvaient les
Amérindiens d'être devenus, à travers lui, lourds, visibles, in-transformables,
bref d'avoir été rejetés de l'univers des êtres de pouvoir ... à celui des
créatures ordinaires
Il faut dire aussi que la principale conséquence de cette perte est le mal, la
souffrance.
Les parures et les danses de fête trouvent leur justification dans
l' effort de l'essor vers le ciel des origines, le paradis perdu
à la fois mime, répétition
et tentative réelle et vaine de lutter contre la volonté du démiurge.
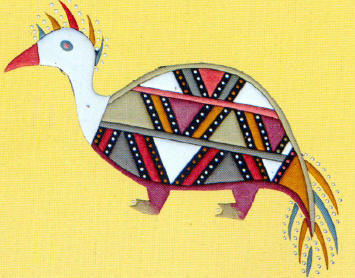
La notion d'une destruction du monde primordial, brûlé par le feu et submergé
par les eaux, existe également chez les Tupi ; mais certains d'entre eux,
à la différence des Wayana et des Carib en général, qui imaginent un "bonheur"
après la mort, cherchent pendant leur séjour sur terre à gagner le paradis, la
«
terre sans mal », qui correspond au lieu où le héros a pu échapper à ces
cataclysmes, et où se trouvent de « merveilleux abatis qui portent des fruits
par eux-mêmes ... en quelques instants ».
Pour les Wayana l'âme/double du défunt quitte son corps dès le
décès et doit, pour accéder au paradis éternel, le «ciel sans mal »; pourrait-on
dire,
elle doit franchir un pont étroit suspendu au dessus d'un fleuve de sang (ou de feu)
grouillant de poissons carnivores pendant que des génies mal intentionnés
(nommés kënekë : « regardes ») essaient de la distraire afin de provoquer sa
chute .
Dans ce cas (il s'agit surtout de femmes qui se sont faites avortées, d'asociaux
notoires...), elle est dévorée.
Bref la destruction de ce premier monde serait lié à l'embrasement, provoqué par
Kuyuli, du fromager géant qui joignait la terre au ciel et dont la trace
persiste sous la forme de la voie lactée, kumake ëhewalutpë (l'embrasement passé
du fromager).
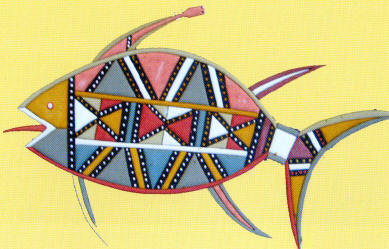
Kuyuli, qui a littéralement imprégné l'univers et qui, sous
différents avatars que nous avons vu précédemment, a créé le monde, se replie
alors définitivement dans son séjour céleste,
privant les niveaux inférieurs d'une
grande partie de leur capacité de métamorphoses :
Nous avons perdu le Monde du rêve
Au final nous avons perdu la possibilité de réaliser ce qu'il y a de céleste en
nous,
notre part de magique, de merveilleux,
cette attitude mentale, cette vision de l'univers, cette interprétation du monde dans laquelle l'imagination refuse de se laisser
freiner et/ou enfermer par la raison et par l'expérience .
Nous aurions pu monter au ciel,
vivre une éternelle félicité,
si seulement nous
n'avions pas trompé Kuyuli
ne l'avions pas humilié en se moquant de ses
plaies.
Le paradis, qui est le séjour des kuyuli et sans doute aussi des âmes
des défunts, est désormais hors de portée.
C'est-là le point important des
croyances religieuses wayana.
Abandonnée de Kuyuli, l'humanité doit se
débrouiller seule,
les hommes ne peuvent plus compter sur le démiurge :
ils vivent dans un
monde pesant, éphémère, inféodé à celui du rêve.
Seuls les chamanes pourront encore partiellement accéder au "vrai monde"
La transformation est liée à la création , elle en constitue la
condition
et c'est parce que le premier monde n'était pas figé, qu'il existait
sous le règne de la
transformabilité, de la malléabilité, qu'il a pu s'actualiser dans autant de
formes.
Seules les pensées créatrices des kuyuli, ces avatars du Pouvoir, ont
contribué à l'enrichir, à le compléter :
le besoin ou le désir,énoncés,
suffisaient à tresser, c'est-à-dire à rendre solide et figé.
La principale différence, en fin de compte, entre les esprits et les
humains, ce n'est pas l'invisibilité des uns et la visibilité des autres"' (en
fait, les esprits peuvent se rendre visibles, et les chamanes peuvent devenir
invisibles) :
mais c'est la perte du pouvoir général de métamorphose des seconds.
Seuls parmi les hommes les chamanes peuvent encore actualiser cette étonnante potentialité qui fonde leur rôle
.Le don spécial des chamanes, que Kuyuli a déposé en eux,
ce n'est pas tant celui de « voir » (pouvoir de double-vue) que celui de pouvoir
se transformer
(c'est-à-dire d'accéder au monde des origines) pour mobiliser l'action des
différents esprits (jolok) dans un but thérapeutique ou morbigène,
c'est-à dire pour modifier l'état des choses.
Or, être capable de faire faire, c'est bien le fondement même de tout pouvoir.
Le chamane est finalement, « un noeud de transformation qui actualise le temps des origines », un passeur de frontières.
Non
seulement les chamanes se métamorphosent, mais ils transforment : reproduisant
ainsi la geste originelle de Kuyuli,
c'est en parlant
et en soufflant sur du tabac tressé qu'ils peuvent fabriquer des « esprits ».
Le
tabac ( ou d'autres substances plus véneuses ou planantes) est sans doute le plus puissant catalyseur de transformation pour les Wayana.
Ainsi dans leur langue le terme tanuktai = transformer veut dire
aussi « retrousser » :
or c'est bien en quelque sorte sa peau que
le chamane retrousse, totalement, pour s'évader de sa forme actuelle,
laissant l'ancienne enveloppe de peau sur place afin que les esprits l'enfilent à tour de rôle.
Il y aurait beaucoup à dire r le rôle de l'enveloppe corporelle dans le
processus de transformation....cela nous entraînerait un peu trop loin je
pense...
Les "kuyuli" non seulement sont ubiquitaires, immortels,
protéiformes,
ils peuvent se transformer à loisir,
mais ils ont aussi la capacité de
réapparaître longtemps après leur première manifestation, et de jouer un
rôle dans l'histoire des hommes, ou plusieurs rôles même (ainsi Sikëpuli
: ami
du démiurge lors de la création du monde, iparticipera aux guerres inter-ethniques).
Ce sont des personnages éternels, vivant dans une dimension
qui échappe au temps (et aux regards du commun des mortels), au malheur et à la
tristesse, contrairement à notre monde à nous, celui des humains :
c'est leur
sort qu'ambitionnent les Wayana.
Ici se trouve la source de leur désir de transcendance qui se manifeste notamment à travers des rituels (comme celui du maraké) associant prescriptions comportementales parures (notamment de plumes), danses, musiques, dans le but de mimer ou de réunir les conditions de l'ascension/métamorphose.
Si le règne des métamorphoses a cessé quand le monde a pris son aspect actuel,
il n'est pas pour autant définitivement clos :
par intermittence. et dans
certains domaines précis, il trouve encore moyen de se réaliser.
Ainsi, certains
esprits de la forêt peuvent-ils prendre apparence humaine ou plutôt vivre sous
deux apparences, visible et invisible.
Ainsi un chamane peut provoquer la
transformation de certaines personnes en jaguar.
Par ailleurs, on peut encore assister à des métamorphoses : telle personne a vu un poisson à corps de chenille (puisque la transformation débute toujours par la tête) ; telle autre a observé un oiseau ou un poisson dans cet état intermédiaire ; les poissons qui repeuplent les mares quand vient la saison des pluies sont aussi le produit de la transformation de chenilles...
La chenille - qui va devenir chrysalide, puis papillon - est l'emblème même de la métamorphose ; elle joue un rôle considérable dans la culture wayana, où elle est partout ou presque présente (que ce soit dans les interdits, l'artisanat, les récits...).
Chenille et métamorphose sont, redisons-le, des piliers de la représentation wayana du monde et de l'usage qu'ils en font.
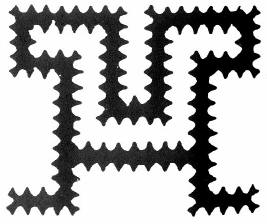
Motif de vannerie "Matawat" de la chenille
Notre terre, selon la mythologie des wayanas est constituée par le ciel de jadis, effondré.
Elle est plate
comme une galette de manioc,
et surnage au-dessus d'une étendue d'eau, laquelle serait le royaume d'« esprits primitifs » (ipo) qui nous dévoreraient s'ils le
pouvaient .
Isolée comme un île , la terre est surmontée par un toit en forme de dôme
le Tukusipan en est l'illustration et le rappel
il symbolise le ciel (kapu), soutenu par des poteaux ou
piliers (kapu epu) qui reposent à ses confins.
Là, à l'horizon, le ciel'" et la
terre sont mitoyens.
Un auteur rapporte : « On me demanda si là-bas, très loin sur le
fleuve Amazone, le ciel est plus proche de la terre qu'ici. Quand, en 1903,
quelques Wayana nous rendirent visite sur le rocher [inselberg] Knopoiamoi, qui
a 500 m de haut, ils crurent qu'on y était moins loin du ciel » (ibid).
Nous croiserons plus loin l'image de gens parvenus au sommet d'un
inselberg pour y faire des incantations afin de se transformer, c'est-à-dire de
partir vers le ciel.