

J'avais promis à nat de venir arbitrer
le "match" de foot... ça me rappelait
le vieux temps où j'animais une équipe de foot au collège de l'étoile du
matin... une équipe internationale qui connut au Japon de grands succès et fut
plusieurs fois invitée par des université prestigieuses...
au point où quand Sr Stanley Rous venait faire des tournées de promotions
pour lancer ce sport dans un Japon tourné alors vers le Yakyu ( base
ball) ... nous étions appelés à des démonstrations... et avons pu avoir nos entrées ainsi dans les coulisses de
l'âme japonaise...( ura Nippon= le japon de l'envers du décors)

Mais quelles sont les coulisses des wayanas...
?
ce n'est pas un
séjour si bref qui peut le dire...
en tous cas à en croire la vitalité des gosses, leur goût du jeu on voit que
ce qui compte c'est le plaisir... la sensation et pas du tout le résultat... le brésil n'est
pas loin...!!!
le mieux dans tout cela c'est que sur la pelouse à côté les filles s'entraînaient
au.. .rugby !
c'est vrai que chez les wayanas ce sont les femmes qui font les travaux de force
...et assurent le collectif !
Nat rendit les armes assez rapidement à cause de la chaleur... mais après avoir été efficace ( 2 buts sur deux montées) et les cloques de moustiques qui le dévorent chaque nuit qui ont fait sa popularité sous le nom de scène de opak siku (pisse de moustique)

Je leur
ai donné rendez vous chez André auquel j'ai présenté mes excuses mais ai
expliqué que je ne voulais
pas déranger ni monopoliser... d'où ma réserve depuis notre arrivée
Je l'ai remercié d'avoir oeuvré et donné sa bénédiction à notre
entreprise ce qui avais permis d'obtenir les autorisations nécessaires...
et puis nous avons parlé...parlé...parlé... c'est un bavard ...moi aussi...
et nous sommes du même pays... La tour du Pin... Pierre bénite... Lyon...tout cela nous
unit
Grâce à lui
j'ai pu me faire une idée un peu plus claire des indiens :leur origine asiatique comme tous les amérindiens semble
certain...
on sait qu'ils s'installèrent il y a très longtemps dans le bassin de
l'Amazone même si les documents manquent ... seule reste une tradition orale... quelques
outils parfois... et un monceau de légendes
Disons qu'avant le 17èmùe siècle date des
premiers contacts
avec les blancs existaient au NW de l'amazone dans la région du Brésil actuel
toute une série de groupes, de tribus et de clans... qui se différenciaient par
leurs langues... leurs coutumes et leur façons de vivre...
des textes mythiques
racontent la création du monde (nous en reparlerons) une époque à en croire les Wayanas
où ces groupes endogames se détestaient spontanément ;
une
période où le sang répondait au sang dans un cycle sans fin.
Les Wayanas en gardent le souvenir de temps barbares, où la peur était
permanente, les frustrations constantes.
Où, toujours sur le qui-vive, ils se
déplaçaient sans cesse dans l'ombre du sous-bois, à l'écart des grands fleuves.
leurs habitations étaient temporaires... leurs abattis aussi...
On note dans ces récits anciens une tendance générale à prendre la guerre comme
une fatalité des temps, engendrée par la vie en forêt qui incite à la haine
d'autrui,
la marque d'un passé révolu mais auquel les gens de jadis ne
pouvaient pas échapper...
Le moteur de ces guerres était la vengeance aveugle, automatique (« juste comme
cela ! ») : on devait absolument venger les siens et, quand certains
petits groupes locaux n'y arrivaient plus par carence numérique, ils s'alliaient
à d'autres pour le faire...
Les données écrites dont nous disposons permettent de conjecturer qu'au moment
du contact avec les premiers explorateurs Blancs au XVIIème siècle, et ce jusqu'au
XXème, l'immense zone comprise entre le Trombetas à l'ouest, l'Amazone au
sud, le Jari à l'est et le Haut Corentyne au nord, était essentiellement peuplée
de groupes "carib "venus de l'est, de la zone du Haut Negro ou du Haut Branco où,
vraisemblablement, ils étaient parvenus depuis les alentours du mont Roraima.
Chacun se nommaient par référence à un animal pour la plupart, et entretenaient
avec celui-ci une relation de ressemblance à travers une particularité
corporelle : intonation de voix, spécificité morphologique, coiffure, type de tatouage... etc...
Il y avait ceux de l'Agouti ( Akuliyana), ceux de l'ara bleu( Alalawayana), ceux
de la fourmi manioc ( Kïyawekeyana) , ceux de la luciole(Kukuyana) ...etc...
(c'était la même chose pour les clans japonais au moyen-âge... consultez
Kurosawa)
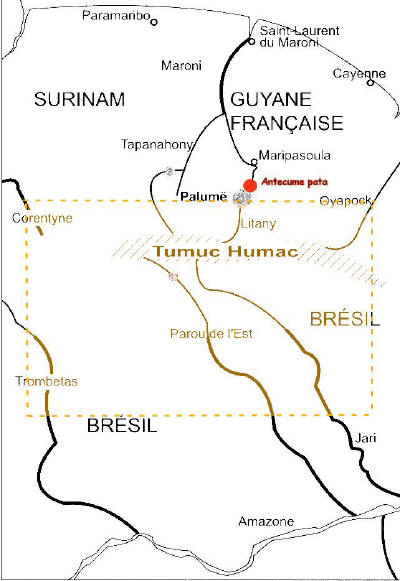
en pointillé zone des "combats inter-tribaux"
Ces groupes (dont on trouve des traces écrites dès le début du
XVIIe siècle), de l'ordre d'une centaine, bien qu'appartenant au fonds carib, se
distinguaient sur le plan linguistique en plusieurs ensembles.
Ceux ayant majoritairement participés à la constitution de l'ethnie Tilïyo sont
les plus septentrionaux. Ils bordaient, au nord et à l'ouest ceux qui ont donné
naissance à l'ethnie wayana et, plus au sud, à l'ethnie apalai.
Les relations
entre eux étaient complexes fait de troc (rituel), de rapt de femmes et de
guerres d'escarmouches..
Ces dernières s'intensifièrent avec l'introduction des biens occidentaux qui
allaient créer un bouleversement majeur dans les sociétés amazoniennes, sur fond
de choc démographique massif dû aux épidémies elles aussi importées....
Aussi le XVIIIème semble avoir été le grand siècle des guerres de clans. Dès
lors, des coalitions de clans ou de fragments (groupes locaux) de clans, se
formèrent à la fois sur des critères de proximité géographique et de
compatibilité linguistique : le vieux" Sante", du village Twenke, précise que «
les
gens se battaient car ceux qui ne parlaient pas la même langue ne voulaient pas
se rencontrer », en quoi il rejoint le récit de la grand-mère Pelipïn :
"en
créant les langues, le démiurge a semé la graine de la discorde" ....une version
wayanisée de la tour de Babel comme quoi la bible n'a pas tout inventé... à
moins que des missionnaires soient parvenus vivants jusqu'à eux...
Dans la réalité, il y eut cependant de nombreuses infractions à cette tendance
générale : ainsi, par exemple, des « négociants » Wayana ont intégrés l'ethnie
tupi Wayâpi ...d'autres se firent wayanas...
Par accrétions successives et continues, le paysage social de la région se
modifia.
Une paix relative finit par s'établir, progressivement, dans la
première moitié du XIX ème siècle, motivée par la réduction démographique, les
frustrations liées à la vie dangereuse, traquée, fruste, du sous-bois et par
l'attrait pour les biens occidentaux, tandis que les clans « quittaient » la
forêt pour s'établir aux abords des grands fleuves tout en se mélangeant entre
eux (mais certainement pas n'importe comment !).
Quoiqu'il en soit, les ethnies actuelles, Apalai, Wayana, Tilïyo et Akuliyo vont
progressivement émerger de cette dynamique vers la fin du XIXe ou le début du XXe siècle.
L'idée de "sortir" de la forêt de la forêt est liée chez les Wayana à l'idée
d'une exposition aux regards, d'un appel aux échanges et d'un progrès -
irréversible,et toute une dialectique se noue autour des séries suivantes :
sous-bois / guerre / clans / temps barbares et berges / paix / négoce / ethnies
/ modernité.
...Entre temps les enfants étaient arrivés après un dernier bain... et sa femme avait servi un bon diner "à la française" poulet au gingembre sur un bol de riz! ... avec de la bière... on s'est régalé !
mais poursuivons...
Cependant, les Wayana n'ont pas oublié leurs racines
claniques et continuent de les utiliser comme référents identitaires, ainsi
qu'on s'en aperçoit pour peu qu'on les interroge à ce sujet. Mais, avec les
jeunes générations, il y a une nette tendance à rejeter ces stigmates d'un passé
violent et barbare, à l'opposé de l'occidentalitée convoitée.
La guerre guyanaise était faite d'escarmouches et de raids, nocturnes.
Sa
stratégie est la surprise, puis la fuite après avoir fait le plus de ravages
possible.
Pour la durée du conflit, on choisissait un chef de guerre, qui était
assisté d'un chamane.
Le chef, selon les vieux Wayana, n'était pas nécessairement un guerrier, il
n'avait donc pas l'obligation de se battre ni d'être sur le théâtre des
opérations. On nommait ce chef ënetën, « celui qui regarde », « celui qui voit
». Il était élu par les guerriers en fonction de plusieurs critères : il devait
être bon orateur, rusé, mais aussi connaître parfaitement les chants de guerre
kalau que les guerriers reprenaient après lui ; il est certain que ce
choix revêtait également un caractère politique