

On admet que des akwalinpë peuvent se réincarner dans certains animaux mais non
dans des végétaux. Cette réincarnation n’a aucun caractère systématique.
PRINCIPES VITAUX DES ANIMAUX ET DES VÉGÉTAUX
Ces notions ont une grande importance aux yeux des Wayana, qui vivent en étroite
communion avec la nature et croient à une interpénétration constante de la vie
humaine et
de la vie animale dont elle est issue.
La plupart des Wayana pensent que les animaux, comme les hommes, possèdent un
akwali, mais il ne leur semble pas capable d’agir sur les hommes, et ils ne s’en
préoccupent
pas. Par contre, ils redoutent :
- Les akwalinpë humains fixés sur les animaux suivants : la biche kupao, le
fourmilier
walisipsik, l’oiseau waiolo, l’oiseau oglaé (engoulevent). On évite de les tuer,
comme de les
capturer.
- Certains animaux sont porteurs de yolok, et de ce fait sont capables de nuire
directement
aux humains, même à distance : ce sont le vautour kutkutuli, l’araignée crabe,
la loutre ;
le kutkutuli est particulièrement redouté, car il a le pouvoir d’enlever l’akwali
des hommes.
A sa vue on se cache sous les cases, ou on tire des coups de fusil en l’air pour
le faire fuir
(mais on ne tire jamais cet oiseau au posé, car le tuer aurait pour effet de
libérer le yolok
qu’il porte, et de le rendre plus nuisible encore).
La loutre est appelée " canot de yolok " on évite de tuer les loutres et de
les approcher.
Cette notion d’animaux porteurs de yolok ne doit pas être confondue avec celle
d’un
esprit collectif de l’espèce. ( dont nous avons déjà parlé)
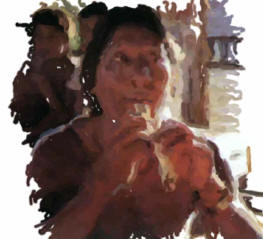
Pour ces trois espéces animales, et
pour celles-là seulement, on considére qu’un yolok est fixe sur chaque individu,
et posséde
une existence autonome.
Enfin, on redoute particulièrement un principe vital appelé Zëwë (le même mot
désigne
la folie) qui peut se fixer sur les hommes et les rendre fous.
Cette notion est parallèle à celle de l’akwalinpë pour les hommes. Le Zëwë est
libéré à la
mort de l’animal.
Tous les animaux possèdent un Zëwë, mais il est d’autant plus redoutable que
l’animal
est gros.
On craint particulièrement à cet égard le cochon sauvage, le pakira,
le tapir, la biche,
l’oiseau hocco, le poisson kalanan.
Les Wayana considèrent que le Zëwë n’est pas à craindre pour un adulte en bonne
santé.
Le chasseur ne prend à cet égard aucune précaution particulière et n’effectue
aucun rite.
On peut noter seulement la coutume de déposer le gibier aux abords du village,
la femme
allant le chercher
(Cette coutume en voie de disparition n’est d’ailleurs pas générale. )
Par contre les enfants en bas âge, les malades, les jeunes garçons qui viennent
de subir
le maraké, et d’une façon générale ceux dont l’akwali est mal fixé au corps, ont
tout a craindre
du Zëwë . Ils doivent éviter de s’approcher des gros animaux, morts ou
vivants et de manger
leur chair. C’est la crainte du Zëwë qui explique les sévères restrictions
alimentaires que s’infligent
en pareil cas les Wayanas.
Si l’on apporte un gros animal au village, on éloigne les jeunes enfants et les
malades
de la case où on le dépèce.
Pour les végdtaux on croit à la présence dans les arbres d’un principe appelé itpa susceptible d’agir sur les hommes. Ce principe subsiste dans les ustensiles et outils découpés dans du bois, notamment les canots et les bancs.
On raconte que jadis, un Indien a vu bancs et outils de
bois danser
dans le village. C’est ainsi que les Indiens ont découvert la réalité du itpë.
Les végétaux cultivés, notamment la patate et la banane, ont également un
principe
itpë, capable de se fixer sur les humains affaiblis et de les rendre malades.
Les restrictions
alimentaires infligées aux parents des jeunes enfants, aux malades, aux tepiem,
portent
également sur les plantes cultivées, à l’exception du manioc.
Les offrandes de nourriture, et notamment l’offrande de fruits faits au symbole
taphem,
témoignent aussi de la croyance en un principe spirituel des végétaux.
Enfin rappelons que les Wayana considèrent l’univers comme le champs d’action d’entités innombrables
qu’ils désignent sous le nom de yolok. Ces esprits, seuls les chamans les
voient, mais les gens
ordinaires ont le sentiment, on peut même dire la sensation physique de leur
présence; ils
croient les entrevoir dans la brousse, ils distinguent leur voix parmi les bruits
nocturnes de la forêt.
La présence constante des yolok fait. partie de l’univers familier des Indiens.
Ce qui caractérise l’action de ces yolok est, l’individualisme et. l’arbitraire.
On admet
qu’ils sont groupés en familles, qu’ils ont. des femmes et des enfants, mais ils
n’ont. pas de
chefs, ne sont soumis à aucun principe supérieur, et chacun agit comme il lui
plaît, sauf dans
la mesure où un chaman a su se le concilier et l’asservir.
Ces esprits sont sans exception hostiles aux hommes et représentent pour eux un
danger
permanent : de même que les hommes se nourrissent de la substance des animaux,
les yolok
ont pour nourriture habituelle l’akwuli des hommes; ils complètent cette
nourriture en
consommant les principes spirituels des champignons.
Les Wayana disent que les
champignons,
piupiu, sont. la cassave des yolok; c’est pourquoi eux-mêmes s’en abstiennent.
Les Wayana considèrent que ces yolok sont mortels. Dans plusieurs mythes, des
yobk
sont mis à mort. par des hommes.
Où vivent les yolok, quelle apparence ont-ils ? Ici les informations sont
beaucoup moins
concordantes.
D’une façon générale les Wayana font une nette distinction entre les yolok
proprement
dits, qui vivent soit dans le ciel soit en brousse, et les esprits des eaux, Ipo.
Les chamans Wayana donnent une description concordante du pays des yolok.
Quand leur akwali s’étant séparé de leur corps reste dans la cabane mumnë,
parvient.
au premier ciel, se guidant sur le fil spirituel "yolok iwa ", bien qu’il fasse
nuit sur terre il
voient, les yolok en pleine lumière.
Ils ont l’apparence d’Indiens, vivent dans
des villages au
bord des rivières, et répondent au chaman dans la langue ordinaire.
Ces yolok portent presque tous des noms d’animaux, de végétaux ou d’objets,
parfois
suivis du terme imë (grand, immense) tels que Peti (pigeon), Poinëkeimë (grand
cochon
sauvage). Quand, prenant l’interrogatoire en sens inverse, on pose la question
ainsi: oti
réside l’esprit Poinëkëimë, à quoi ressemble-t-il ? on répond régulièrement : il
réside en
brousse, il a l’apparence‘d’un très grand cochon.
Les chamans ne paraissent pas percevoir de contradiction, et il semble qu’on
doive
définir les yolok comme pouvant résider indifféremment en brousse et au ciel, et
comme
pouvant à volonté prendre l’apparence humaine
une autre façon de dire qu'il conviendrait d'approfondir... mais je ne voudrai pas lasser
alors quelques images encore...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sur le tissage : activité féminine: depuis le filage du coton cultivé sur l'abattis jusqu'à la décoration et la teinture au roucou ...avec sa variante : l'enfilage des perles !