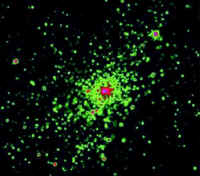 En guise de conclusion...
En guise de conclusion...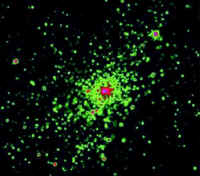 En guise de conclusion...
En guise de conclusion...
Si nous nous résumons un
peu l'ensemble de ce que nous avons médité écoutons L'Astrophysicien
Trinh Xuan Thuan:
" Il
y a
Cette globalité du réel, plusieurs expériences en
physique nous l'imposent. Dans le monde atomique
et subatomique, les expériences de type EPR nous
disent que la réalité est « non séparable », que deux
grains de lumière qui ont interagi continuent à faire
partie d'une seule et même réalité. Quelle que soit
la distance qui les sépare, leurs comportements sont
instantanément corrélés, sans aucune transmission
d'information.
Quant au monde macroscopique, sa
globalité nous est démontrée par le pendule de
Foucault dont le comportement s'accorde non pas à
son environnement local, mais à l'univers tout entier.
Ce qui se trame sur notre minuscule Terre se décide
dans l'immensité cosmique.
Le concept d"interdépendance dit que les choses
ne peuvent se définir de manière absolue, mais seulement relativement à d'autres.
C'est, en substance, la
même idée qui définit le principe de la relativité du
mouvement en physique, énoncé pour la première
fois par Galilée, puis repris et développé au plus haut
point par Einstein.
« Le mouvement est comme rien »,
disait Galilée. Il voulait dire par là que le mouvement
d"un objet ne peut être défini de façon absolue, mais
seulement par rapport au mouvement d'un autre
objet. Aucune expérience ou mesure faite par un passager dans un wagon de chemin de fer qui se déplace
à une vitesse constante et dont toutes les fenêtres
sont fermées ne lui permettra de dire si le wagon est
immobile ou en mouvement. C"est seulement en
ouvrant une fenêtre et en regardant le paysage défiler
que le passager s-en rendra compte. Tant qu'aucune
référence n'est faite à l'extérieur, le mouvement est
équivalent au non-mouvement.
Les choses n'ont pas d'existence en elles-mêmes, mais seulement par rapport à d'autres événements, dit le bouddhisme. Le
mouvement n'a de réalité que par rapport au paysage
qui passe, dit le principe de la relativité.
Le temps et l'espace ont aussi perdu le caractère
absolu que leur avait conféré Newton. Einstein nous
dit qu'ils ne peuvent se définir que relativement au
mouvement de l'observateur et à l'intensité du champ
de gravité dans lequel il se trouve. Aux abords d'un
« trou noir », singularité dans l'espace où la gravité est
si intense que même la lumière ne peut plus en sortir,
une seconde peut prendre des airs d'éternité. Comme
le bouddhisme, la relativité dit que le passage du
temps, avec un passé déjà révolu et un futur encore à
venir, n'est qu'illusion, car mon futur peut être le
passé d'un autre et le présent d"un troisième : tout
dépend de nos mouvements relatifs. Le temps ne
passe pas, il est simplement là.
Découlant directement de la notion d'interdépendance il y a celle de la vacuité qui ne signifie pas
le néant mais l'absence d'existence propre. Puisque
tout est interdépendant rien ne peut se définir et
exister par soi-même. La notion de
propriétés intrinsèques existant en elles-mêmes et par elles-mêmes
n'est plus de mise. De nouveau la physique quantique
nous tient un langage étonnamment similaire. D'après
Bohr et Heisenberg nous ne pouvons plus parler
d'atomes ou d'électrons en termes d'entités réelles
possédant des propriétés bien définies, comme la
vitesse ou la position. Nous devons les considérer
comme formant un monde non plus de choses et de
faits, mais de potentialités. La nature même de la
matière et de la lumière devient un jeu de relations
interdépendantes : elle n'est plus intrinsèque, mais
peut changer par l'interaction entre l'observateur et
l'objet observé. Cette nature n'est plus unique, mais
duelle et complémentaire. Le phénomène que nous
appelons « particule » prend la forme d'ondes quand
on ne l'observe pas. Dès qu'il y a mesure ou observation, il reprend son habit de particule. Parler d"une
réalité intrinsèque pour une particule, d'une réalité
existant sans qu'on l'observe, n"a pas de sens car on
ne peut jamais l'appréhender. Rejoignant le concept
bouddhique de samsara, qui veut dire « événement »,
la mécanique quantique relativise radicalement la
notion d'objet en la subordonnant à celle de mesure, c'est-à-dire à celle d'un événement. De plus, le flou
quantique impose une limite fondamentale à la précision de la mesure de cette réalité.
Il existera toujours
une certaine incertitude soit dans la position, soit
dans la vitesse d'une particule. La matière a perdu sa
substance.,,
La notion bouddhique d'interdépendance est
synonyme de vacuité qui, à son tour, est synonyme
d'impermanence. Le monde est comme un vaste
flux d'événements et de courants dynamiques tous
connectés les uns aux autres et interagissant continuellement. Ce concept de changement perpétuel et
omniprésent rejoint ce que dit la cosmologie moderne. L'immuabilité aristotélicienne des cieux et
l'univers
statique de Newton ne sont plus. Tout bouge, tout
change, tout est impermanent, du plus petit atome à l'univers entier en passant par les gala)des, les étoiles
et les hommes.
Propulsé par une explosion primordiale, l'univers
se dilate. Cette nature dynamique est contenue dans
les équations de la relativité. Avec la théorie du big
bang l'univers acquiert une histoire. Il a un commencement, un passé, un présent et un futur. Il mourra un
jour dans un brasier infernal ou dans un froid glacial.
Toutes les structures de l'univers - planètes, étoiles, galaxies ou amas de
galaxies - sont en mouvement
perpétuel et participent à un immense ballet cosmique : mouvement de rotation autour
d'elles mêmes, de révolution, d'éloignement ou d'approche
les unes par rapport aux autres. Elles ont aussi une
histoire : elles naissent évoluent et meurent. Les
étoiles suivent des cycles de vie et de mort qui se
mesurent en millions, voire en milliards d'années.
Le monde atomique et subatomique n'est pas en
reste. Là aussi, tout est impermanence. Les particules
peuvent changer de nature : un quark peut changer
de famille ou de « saveur », un proton peut devenir un
neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino.
Dans des processus d"annihilation avec l'antimatière,
la matière peut se muer en pure énergie. Le mouvement d'une particule peut se transformer en particule,
ou vice versa. En d"autres termes, la propriété d'un
objet peut se muer en objet. Grâce au flou quantique
de l'énergie, l'espace qui nous entoure est peuplé
d"un nombre inimaginable de particules dites « virtuelles », à l'existence fantomatique et éphémère.
Apparaissant et disparaissant dans des cycles de vie et
de mort d'une durée infinitésimale, elles exemplifient l'impermanence au plus haut degré.
Le réel peut donc être perçu de diverses façons,
et des chemins différents, l'un issu du monde intérieur l'autre du monde extérieur, peuvent mener à la
même vérité. Le bouddhisme ne s"étonnera sans
doute pas de cette concordance. Puisque le monde
phénoménal est inévitablement observé à travers le
filtre de la conscience, et du fait que cette dernière est
interdépendante du monde extérieur, la nature fondamentale des phénomènes ne peut être étrangère à
l'esprit éveillé du Bouddha.
J'ai toutefois une réserve à formuler sur l'approche bouddhique du « principe anthropique » selon
lequel il y a eu un réglage extrêmement précis des
constantes physiques et des conditions initiales de l'univers pour que celui-ci héberge la vie et la
conscience. Pour rendre compte de ce réglage, j"ai fait
le pari pascalien de l'existence d'un principe créateur.
Ce principe - je le conçois dans le sens de Spinoza et
d"Einstein - se manifeste dans les lois de la Nature et
fait que le monde est rationnel et intelligible. Cette
position va à l'encontre de celle du bouddhisme qui
n'admet pas l'idée d"un principe créateur (ou d'un
Dieu horloger). Selon lui, l'univers n'a nul besoin
d'être réglé pour que la conscience apparaisse : les
deux coexistant fondamentalement ils ne peuvent s'exclure. De nouveau, le concept d'interdépendance
offre une
explication.
J'admets que cela puisse justifier le réglage de l'univers. Mais il est moins évident que ce concept puisse répondre à la question existentielle de Leibniz : « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? » J"ajouterai : « Pourquoi les lois physiques sont-elles ce qu'elles sont et non autres? » Ainsi nous pourrions très bien imaginer vivre dans un univers décrit seulement par les lois de Newton. Or ce n'est pas le cas. Ce sont les lois de la mécanique quantique et de la relativité qui rendent compte de l'univers connu.
L'optique bouddhique soulève d'autres points
d'interrogation. S"il n'y a pas de créateur, l'univers ne
peut être créé. Il n'a donc ni commencement ni fin. Le
seul univers compatible avec le point de vue bouddhiste est donc un univers cyclique, avec une série
sans fin de big bang et de big crunch. Scientifiquement, le fait que l'univers
va un jour s"effondrer sur
lui-même, donnant lieu à un big crunch, est néanmoins loin d'être établi. Cela dépend de la quantité
totale de matière invisible dans 1"univers, or cette
quantité n'est pas connue. Selon les dernières observations astronomiques, l'univers paraît ne pas contenir assez de matière invisible pour arrêter et inverser
son mouvement de dilatation, ce qui semblerait en
l'état actuel de notre connaissance du cosmos, exclure
un univers cyclique. Quant au concept de flots de
conscience coexistant avec l'univers matériel dès les
premières fractions de seconde du big bang, la science
est encore très loin de pouvoir le vérifier. Certains
neurobiologistes pensent qu'il n'est nul besoin d'un
continuum de conscience coexistant avec la matière,
que le premier peut émerger de la deuxième, une fois
passé un certain seuil de complexité.
Poussières d'étoiles, nous partageons la même
histoire cosmique avec les lions des savanes et les
fleurs de lavande. Connectés à travers l'espace et le
temps, nous sommes tous interdépendants. Le simple
fait de respirer nous relie à toute l'espèce humaine :
les milliards de molécules d«oxygène que nous inhalons avec chaque bouffée d'air ont été un jour ou
l'autre dans les poumons de chacun des cinquante
milliards d'individus à avoir vécu sur Terre. Cette
perspective cosmique et planétaire souligne non seulement
notre interdépendance, mais aussi la vulnérabilité de notre planète et notre isolement parmi les
étoiles. Les problèmes de l'environnement qui
menacent notre havre dans l'immensité cosmique ( Trinh xuan Thuan)
le plus incompréhensible est que le monde soit compréhensible
de quel mystère ?...le mystère du connaître... dont nous avons vu la fécondité à propos de l'incomplétude
En 1949 un philosophe
Gabriel Marcel a approfondi la question il fait une distinction entre problème
et mystère
le problème étant une question que nous nous posons sur des éléments
considérés comme étalés devant nous...hors de nous...
et le fait de les connaître ne modifie pas les éléments du problème...il n'y
a pas non plus en principe de choc en retour sur nous...
Il y a mystère au
contraire quand celui qui s'interroge appartient à ce que sur quoi il
s'interroge
ainsi l'être est mystère car je ne peux poser de question sur l'être parce
que
je suis;
le mystère est ainsi un problème qui empiète sur ses propres données et qui
les envahit
le mystère abolit ainsi la frontière entre l'en moi et le devant moi
Mystère de l'être ou de
la pensée car nous ne pouvons pas nous interroger sur l'être comme si la
pensée qui s'interroge sur l'être était en dehors de l'être
mystère du connaître aussi la connaissance se suspend à un mode de
participation dont une épistémologie quelle qu'elle soit ne peut espérer
rendre compte parce qu'elle même le suppose
Ainsi le mystère n'est
ni l'inconnaissable...ni une pseudo solution...mais un appel à explorer...pont
intéressant vers la théologie...
le mystère n'est pas ce que l'on ne
peut pas comprendre ...mais ce que l'on aura jamais fini de comprendre
L'acceptation du mystère
de connaître est lié à celle de la finitude de l'homme.
Parler du réel pour le
scientifique c'est tenter de produire au grand jour ses composantes...ce qui
revient à trahir le mystère...dans le résoudre pour autant
une certaine humilité en découle qui passe par l'abandon de certitudes
définitives pour une incomplétude qui ne nie pas la recherche de la vérité
mais qui met en évidence notre incapacité propre à l'atteindre par nous même
tout en nous ouvrant davantage à la profondeur de cette vérité.
Aujourd'hui les sciences
de l'univers et de la vie sont traversés par une sorte de révolution qui fait
retrouver la profondeur et la complexité du réel lui même.
Le sujet est
partiellement réintégré à travers la prise en compte de ce qui relie le
sujet et l'objet
"A partir d'une
réflexion sur la science d'aujourd'hui nous sommes renvoyés au mystère de
l'homme dans l'univers"
Qu'est ce que l'homme ?...cela nous renvoie à Pascal:
" notre intelligence tient dans l'ordre des choses intelligibles le même; rang que notre corps dans l'étendue de la nature ,borné en tout genre cet état qui tient le milieu entre deux extrêmes se trouve en toutes nos puissances .Nos sens n'aperçoivent rien d'extrême, trop de bruit nous assourdit, trop de lumière éblouit, trop de distance et trop de proximité empêchent la vue, trop de longueur et trop de brièveté de discours l'obscurcissent, trop de vérité nous étonne...trop de jeunesse et de vieillesse empêchent l'esprit, trop et trop peu d'instruction; enfin les choses extrêmes sont pour nous comme si elles n'étaient point et nous ne sommes point à leur égard: elles nous échappent, ou nous à elles...voilà notre état véritable; c'est ce qui nous rend incapable de savoir certainement et d'ignorer absolument...notre raison est toujours déçue par l'inconstance des apparences, rien ne peut fixer le fini entre les deux infinis qui l'enferment et le fuient"...
et aussi
" L'homme connaît cette condition de contingence, il l'éprouve tout en cherchant la vérité et en espérant la trouver dans tous les domaines: celui de la connaissance scientifique, celui de la connaissance de l'Être invisible, celui du Bien et du Beau. l'homme n'est qu'un roseau , le plus faible de la nature: mais c'est un roseau pensant. Il ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser: une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le tuer. mais quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parc equ'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il nous faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. Travaillons donc à bien penser: voila le principe de la morale"
Vision d'un monde incertain qui appelle à dépasser
le matérialisme scientifique...
le retrait du fondement...va dans le même sens
il ne faut pas combler trop vite l'incertitude par un retour plus ou moins
masqué des certitudes...
combler le trou d'incomplétude par un dieu bouche trou
mais laissons l'homme accueillir le réel tel qu'il se présente...laissons
travailler une raison ouverte qui apprend à conjuguer l'un et le multiple...à
articuler l'unicité de l'homme à la multiplicité du réel... le mystère n'est
pas de l'ordre de la magie mais d'une intelligence qui progresse sans se suffire
à elle même...
Chercher le sens de l'altérité et de l'unité
fondamentale entre le sujet et le réel C'est faire le choix aussi d'une
intelligibilité...l'existence d'un sens...
Accepter l'altérité, ne pas chercher à réduire le complexe au simple, penser
la différence...voilà ce à quoi le scientifique est conduit.
Le réel n'est pas réductible à nos
représentations...il y a toujours quelque chose qui échappe...et
échappera...
remise en cause aussi de l'objectivité scientifique..elle ne peut
exister...
C'est selon leurs convictions et leurs préjugés que les théories se construisent...on revient indirectement au problème du cerveau...
Pour certains la conscience n'est qu'un ordinateur ultra sophistiqué qui traite l'information selon une boucle stimulus/réponse...tout est réduit à la physico-chimie
Pour d'autres l'esprit est bien plus qu'une simple boite noire qui traite de l'information sur le modèle cybernétique entrée-sortie...il y a un espace de stimulations d'actions virtuelles...un darwinisme mental...le cerveau produit des hypothèses variables sur le monde puis sélectionne celles qui s'adaptent le mieux à la situation considérée...
Il y a aussi ceux qui pensent que le cerveau n'est qu'un support qui n'apporte rien sur le plan de la conscience... permettant seulement à l'esprit de se constituer au fur et à mesure que l'individu se heurte au monde ...
Enfin ceux qui pensent que la rationalité ne peut suffire à expliquer la conscience... il y a quelque chose d'informulable... comme dans l'incertitude d'Heisenberg.
La conscience naît par sauts quantiques à partir d'un état proche de celui des éléctrons existants dans une multitude d'états différents...la conscience fait partie de notre univers.
Finalement comme Jacob ont pourrait souligner que
l'un des titres de noblesse de la démarche scientifique est d'avoir cassé
l'idée d'une vérité intangible ainsi les arts, les sciences, les techniques
ne sont que des manières de jouer le jeu des
possibles..
de même que les mythes
qui fournissent une représentation du monde et des forces qui l'animent
Ces représentations mythiques ou scientifiques font une large place à l'imagination...et pour apporter en sciences une observation de quelque valeur, il faut déjà au départ avoir une certaine idée de ce qu'il y a à observer...il faut déjà avoir décidé de ce qui est possible...de ce qu'est ou n'est pas la réalité...d'avoir une certaine conception de l'inconnu...un peu comme dans les mythes...
Ainsi notre imagination déploie devant nous l'image toujours renouvelée du possible... c'est à cet image que nous nous confrontons sans cesse ce que nous craignons et ce que nous espérons.. .mais nos prévisions se doivent de rester incertaines...l'avenir sera différent de ce que nous croyons... une incertaine réalité
le 18e a eu la sagesse de considérer la raison
comme étant nécessaire
le 19e la folie qu'elle était suffisante
il serait fou de penser au 20e que dis-je au 21 ème qu'elle n'est pas nécessaire...mais l'être humain
a autant besoin de rêve que de réalité...
l'espoir donne sens à la
vie...l'espoir de transformer le monde en un possible qui parait meilleur...l'espoir
d'apaiser, de soigner, de maintenir en vie et de calmer toute souffrance...de
pratiquer la compassion...
la démarche scientifique ne peut constituer une sagesse en elle même...
Pour un chrétien la foi naît d'une rencontre et y
conduit
Croire en quelqu'un c'est le rencontrer et s'en remettre à lui...et lui faire
confiance
c'est la rencontre qui transforme, guérit, fait voir.. .ouvrant à la relation et au chemin du salut..."Ta foi t'a sauvé"
La foi naît également de la prise de conscience par l'homme à se réaliser lui même...idée d'un manque fondamental aussi qu'éprouve l'homme en quête d'infini...insatisfaction de l'âme humaine...image en creux que Dieu a mise au coeur de l'homme...
Tillich disait : toutes les fois que l'absolu,
l'inconditionné est recherché en quelque domaine que ce soit...un chemin vers
la foi est ouvert...la foi est d'être saisi par la puissance de l'Être
même...
Il y a foi quand il y tension entre la participation à l'absolu et la
séparation d'avec lui... la foi cesserait sans la manifestation de Dieu dans l'homme...mais
aussi sans la séparation... autrement il serait possesseur... la foi est la même
que l'intuition de l'amour...
Bien sûr la certitude de la participation naît
pas de l'évidence...elle est de l'ordre d'une connaissance qu'a une personne
l'un de l'autre...ni démonstration,...ni preuves...simplement comme en amour
...des signes...
à quiconque veut trouver ...des signes sont proposés...
mais pour découvrir
quelqu'un encore faut-il vouloir le rencontrer... sans le désir d'accueillir
l'Autre... le
Tout Autre... rien n'est possible...
Il faut prendre ce risque
risque de l'ouverture et non repliement sur des certitudes...
risque du doute...la foi est donnée..le salut est donné par un autre
...risquer l'aventure d'un amour... faire confiance... au mépris du
doute...qui peut conduire au scepticisme...
mais éviter aussi à tout prix l'idolatrie
cela nécessite le courage d'être... qui ne nie pas l'existence du doute mais
qui l'intègre comme expression de sa propre finitude...
risque sans lequel
aucune vie créatrice n'est possible
Importance de la Croix... qui montre qu'en dépit de toutes les forces de destruction la
séparation entre Dieu et l'homme est surmontée par Dieu et qui porte en elle
la
certitude que même l'échec du" risque de la foi " ...que la foi
porte en elle ne peut séparer
définitivement l'homme de Dieu
Dieu transcende l'homme de façon inconditionnelle... d'un amour sans retour...
en dépit du fossé la
puissance de l'être est présente... et celui qui est séparé est toujours
accepté... car
la foi n'est pas une opinion mais un état...
état d'être saisi par la
puissance de l'Être qui transcende tout ce qui est et auquel participe tout ce
qui est
celui qui saisi par cette puissance est capable de s'affirmer car il sait
désormais qu'il
est affirmé par la puissance de l'être lui même.
Importance des signes aussi...
comprendre le signe sera découvrir le signifié à travers le signifiant, le
sensible...
en science les deux restent sur le même plan...pas en foi !
ni un aveugle ni un animal ne peuvent lire... l'un car il ne perçoit pas les
signes ...l'autre parce qu'il ne perçoit pas le sens...
il faut savoir s'accorder aux signes...et au supérieur signifié...
C'est là sans nul doute le rôle de la grâce qui donne ce nouveau
regard...qui répond au oui de l'homme
à l'appel de son désespoir...
le désir de l'homme rencontre alors le désir de Dieu...
grâce et volonté se conjuguent pour donner à la raison les yeux qui font
voir...
sous l'éclairage de la grâce la volonté s'oriente d'elle même car c'est notre
raison qui voit et qui choisit de dire oui et notre volonté qui l'oriente dans
sa quête du Vrai.
L'amour lui suscite la faculté de connaître
et la connaissance légitime à nos yeux l'amour...
On n'aime que ce que l'on connaît... et on connaît par ce qu'on aime !
Amen !
Fin de la méditation