

La dépendance avec la nature, ses frémissements parlent içi ...
Koee-iti (esprit de la
petite anguille ) vivait à Vai-Ee une cascade de Hanavave,
reçu la visite Koee-nui (« grande anguille »). qui vivait dans une caverne sous
la chute d'eau de Kuenui sur Nukuhiva. La petite anguille mangeait
seulement des fleurs et du fruit ; la grande anguille elle la chair de porc et
d'humain.
La petite anguille se vanta de sa maison et de ses approvisionnements
alimentaires et trompa la grande anguille à Hanavave. La petite anguille nagea
vers le haut de la cascade ; la grande anguille a essayé de suivire et s'est
coincée. Les personnes de Hanavave ont alors tué l'anguille, l'ont coupée vers
le haut, et l'ont mangée.
Cette histoire semble enregistrer une bataille entre un grand nombre de
guerriers de Nukuhiva ( ile plus au Nord)et un nombre restreint de guerriers de Hanavave
( de cette île). Les guerriers de Fatu Hiva ont apparemment attiré dans un guet-apens les guerriers de Nukuhiva
dans la vallée étroite de Hanavave. ...et les colonnes fantastiques des
roches qui rayent la vallée de Hanavave seraient les restes de la grande
anguille.
Conséquence directe
de la perception des rapports entre les êtres et leur environnement, la force
qui les habite circule entre eux, les Marquisiens développèrent un système complexe d'interdits
(tapu) qui réglementaient l'usage des lieux et des choses comme les rapports
entre les êtres. Les interdits strictement économiques réglementant l'exploitation d'une
ressource animale ou végétale étaient appelés kahui.
Profondément conscients
de leur dépendance envers la
nature et les forces naturelles qui, par période, dévastent leur univers les
Marquisiens sont soucieux de leurs actes à son égard .
Si on abattait un arbre, pour s'abriter ou voguer en mer, on ne
pouvait le faire qu'en respectant les rites envers les esprits.
On retrouve içi ce que l'on avait appris chez les Wayanas..;et dont on ferait
bien de s'inspirer aujourd'hui en occident pour éviter le "pillage des ressources
naturelles" ou les destructions gratuites mais rénumératrices de l'environnement).
Si l'on taillait
une herminette ce n'était qu'après avoir invoqué les divinités concernées,
depuis celle de la roche jusqu'aux précurseurs du geste créateur, en répétant
chaque parole, étape par étape...
Connaissant parfaitement les atouts, les
limites et les manques de leur territoire, il n'y puisaient qu'en accord avec
les leurs :ceux du passé, ceux du présents et ceux qui, issus de
lui, qui sont sa plus grande
richesse. Pour cela il nommait cette nature dans tous ses aspects,
l'entretenait en veillant à ce que les sources ne s'épuisent pas, que les cours
d'eau soient dégagés, qu'ils ne dévastent pas leur domaine ou ne disparaissent à jamais, que
les poissons ne désertent pas la baie...

La rivière qui irrigue la petite vallée
d'Ouia
A la naissance d'un enfant la famille plantait les arbustes qui fourniraient l'étoffe nécessaire à son existence de même que l'arbre à pain qui le nourrirait. La durée de vie de cet arbre est curieusement voisine de celle d'un être humain et ses récoltes sont abondantes aux âges où celui-ci en a le plus besoin. L'extrême dépendance des Marquisiens envers ce fruit, qui fournissait l'essentiel de son alimentation, explique bien des comportements et font de lui un élément aussi vital que l'eau.


Le fruit de l'arbre à pain qui cuit donne une sorte de "purée fade et bourrative" aussi nourrissante que le pain de chez nous
Les enfants étaient la richesse d'une famille, jamais une charge, et ce trésor s'échangeait dès la naissance. Nombre d'entre eux n'étaient pas élevés par leurs parents (géniteurs) mais par des membres de leur famille ou des alliés.
L'enfance se déroulait sous l'attention des proches : grands-parents, oncles et tantes... mais aussi de tout le clan. Elle était insouciante et heureuse, marquée d'étapes amenant petit à petit l'individu à occuper la place qu'on lui destinait en fonction de ses goûts, de ses aptitudes et du choix fait par lui même, ses parents et ses maîtres artisans, pêcheurs ou cultivateurs avec le conseil des anciens.
Tous
jouissaient d'une très grande liberté, en particulier sexuelle, ponctuée toutefois de "passages" : la superincision du pénis (circoncision en coupant le dessus du prépuce qui alors laisse passer le gland sans que la peau ne soit enlevé), le percement des oreilles, les prémices du tatouage.Cette adolescence était libre de toute occupation contraignante en dehors de périodes de formation, rigoureuses mais courtes : art oratoire, gestuelle et chant qui permettaient à cette "troupe" d'accomplir un tour de l'île, ou de l'archipel, afin de faire revivre les grands moments de leur tradition sur les places communautaires. Les garçons suivaient aussi un entraînement guerrier et devaient répondre à l'obligation de capturer (pêcher selon la terminologie et l'iconographie symbolique) les victimes humaines nécessaires au culte.

Raphaël
Les habitations ne se concentraient pas en villages mais formaient de petits
ensembles dispersés de part et d'autre d'un torrent au centre des vallées, ou
tout au moins à bonne distance de la côte et des cols, pour limiter l'irruption
de flots dévastateurs ou celle de voisins hostiles.
Les facteurs climatiques et le relief n'étaient pas sans importance, de
même que le peu de terrain propice aux cultures et les fortes pentes qui
contraignaient à utiliser au mieux l'espace encombré de nombreux amas rocheux,
tout en évitant les risques de ravinement lors des pluies saisonnières. ( Ce fut
certainement la raison de l'abandon de cette vallée trop difficile d'accès et
trop étroite) Il en
résultait une organisation des vallées selon trois impératifs dont certains
groupes familiaux avaient plus particulièrement la responsabilité : l'usage et
la surveillance de la mer, l'horticulture et enfin les activités liées à la vie
du centre communautaire .
L'aire littorale et la basse vallée correspondent aux
espaces les plus plans des vallées, sensibles aux mouvements de la mer mais où
les plantations ne nécessitent guère d'efforts préalables pour aménager le
terrain. Séjourner en ces lieux était cependant d'autant plus risqué qu'ils
constituaient la zone privilégiée des accrochages et enlèvements intertribaux.
Seuls les pêcheurs et les personnes ayant vocation à protéger ou à échanger avec
l'intérieur y avaient leurs résidences ou paepae (plate-forme en cailloux
supportant un bâtiment en matière végétale) ; elles pouvaient n'être, pour
certaines, que saisonnières suivant les périodes de pêche, de récolte ou en
fonction des alizés.
Il s'y trouvait souvent un lieu de rassemblement public : taha koina ou tohua
et des espaces sacrés voués surtout à la pêche. C'est
seulement avec la fréquentation des bateaux européens ne pouvant mouiller que
dans quelques baies, et avec le soutien des missionnaires, que l'habitat s'y est
concentré de façon durable.( l'espace communautaire libéré étant en général
occupé désormais par l'Eglise !!!)
Les espaces à vocation horticole
: en raison du caractère capricieux du climat et des
besoins des plantes qu'ils utilisaient, étaient répartis en espaces
variant en fonction des qualités du sol et du
degré d'humidité ou d'ensoleillement.
Les endroits reculés offraient des
peuplements spontanés de plantes médicinales et de plantes d'appoint auxquelles
s'ajoutaient des aracées ( racines de la famille de l'Arum), les bananes à cuire de la famille Musa troglodytarum,
courges, etc. Ces réserves naturelles fonctionnaient comme des lieux de
cueillette, de ramassage du bois de chauffe et devenaient très importantes lors
de disettes.
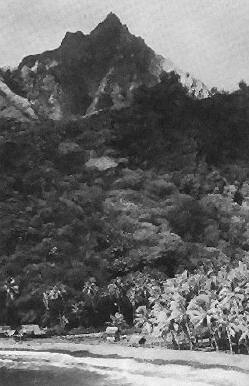
Ouia du vers 1930 d'après le livre de
Thor Heyerdahl
Fatu-Hiva ou le retour à la nature

Ouïa aujourd'hui
Pour les espèces dont on pratiquait la culture, horticulture et
arboriculture, les plantations de faible étendue étaient réparties entre la
basse vallée et les espaces s'étendant du centre communautaire au fond du
territoire ainsi que sur ses flans, selon les besoins des plantes, l'intensité
des soins nécessaires et la fréquence de l'usage qui pouvait en être fait.
Le
développement démographique avait amené à contrôler les phénomènes d'érosion, de
ruissellement et le débordement des torrents. Les terres aisément inondables ou
bien alluvionnées étaient dégagées au maximum des roches et les parcelles
Le centre communautaire
était caractérisé par une plus forte densité de
plates-formes d'habitation et de petits enclos ; situé à bonne distance de la
côte, le relief n'y était pas encore trop accusé et la ligne des crêtes laissait
largement pénétrer la lumière. La vie s'y articulait autour du lieu de
rassemblement à proximité des bâtiments formant l'unité
d'habitation du chef. Celle-ci se distinguait par son étendue et des détails
marquant une distance à respecter : des poteaux anthropomorphes sculptés, l'usage de
matières rouges dans la construction...
Finalement cela ressemblait à un village Wayana ou Kuna
Aux alentours se trouvaient les édifices tapu destinés à la célébration des événements importants ; les
prêtres y conservaient les biens les plus précieux du clan. Dans le même secteur était édifiée la maison des hommes, ou des guerriers, qui servait de lieu de réunion au chef et à ses compagnons. Ils y prenaient leurs repas ou s'y retiraient pour discuter et apprécier leur kava ; les étrangers de passage pouvaient y être abrités.
Les plantations de Tei Tetua dernier habitant d'Ouia
La vie familiale se déroulait en effet autour d'un
bâtiment consacré au repos, au sommeil associé au rêve... d'où son nom ha'e ou
fa'e hiamoe.
Il s'élevait sur le upe ou paepae, plate-forme lithique
rectangulaire à deux niveaux. Cette vie se passait largement sur la terrasse
avant non couverte ; les repas n'étaient pas pris à l'intérieur car il était interdit de souiller ce lieu protégé par de nombreux tapu.
La partie couverte de l'habitation, faite de végétaux, dominait de 40 à 80
cm en moyenne la terrasse. Le ha'e ou fa'e faisait l'objet d'une décoration
soignée : sculpture des poteaux porteurs, tressage ornemental de la poutre
faîtière et autres points de fixation... Pour les bâtiments les plus
prestigieux, les blocs basaltiques à l'avant de l'espace couvert étaient
remplacés par des pierres rectangulaires, taillées dans un tuf volcanique (ke'etu
) et posées de champ.
Aux alentours de la maison se déroulaient la plupart des activités
familiales courantes dont la cuisine dans le fa'e tumau qui se présentait comme
un appentis plus ou moins fermé abritant un four creusé dans le sol (umu). Les
hommes et les femmes ne mangeant ni ensemble ni au même endroit, une
construction, sur une petite terrasse ou sur pilotis, servait aux hommes ; elle
jouait aussi un rôle de garde-manger et d'atelier. Près de ce fata'a, ou
au-dessous, se trouvait une réserve de bois. Lorsqu'un homme de la famille
venait à perdre sa compagne, il s'y installait. L'habitation se trouvant souvent près d'un ruisseau, un bain
était aménagé entre les rochers. Ces divers aménagements étaient complétés de
petits enclos pour les plantes à soigner ou dont l'usage était quotidien.
S'y
ajoutait, à l'écart, un lieu sacré où se dressait l'autel familial. Il pouvait
se présenter soit comme un petit espace clos, soit comme une plate-forme où se
dressaient divers échafaudages en relation avec la mort, une naissance ou tout
acte familial suscitant un geste religieux.
Renseignements empruntés au site
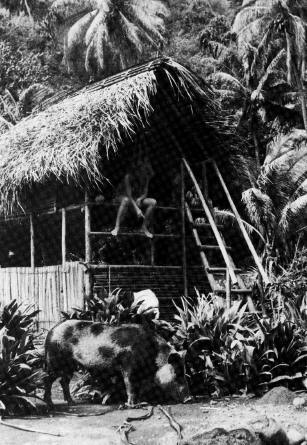
La case réaménagée
par Thor Heyerdahl pour son expérience érémitique
au premier plan un cochon sauvage en liberté

on continue ?