


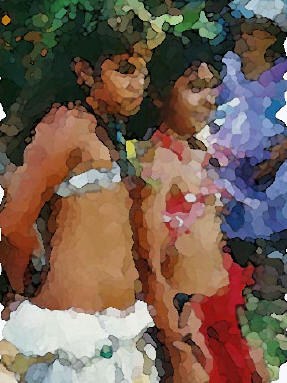
La variété des parures s'exprime avec bonheur tout aussi bien dans l'art de marier le parfum des plantes qu'à
travers toute une gamme de réalisations de plumes, de nacre ou d'écaille...
L'acquisition de parures de cérémonie constituait un événement d'importance et
le pivot d'échanges qui contribuaient de façon non négligeable au maintien
d'alliances, d'où la valeur et le soin apporté à leur réalisation.
La plupart
des matériaux étaient obtenus à l'intérieur de l'archipel mais certaines
nécessitaient des déplacements vers les Tuamotu, pour des nacres plus épaisses
par exemple, Pukapuka et Napuka étant les îles les plus proches à quelques 400
km ( Nous sommes passé pas loin)

Dès la naissance, il était essentiel de créer les conditions d'une propreté rigoureuse qui tendait à faire disparaître toute odeur corporelle en y substituant celle de plantes qui, tout en repoussant les influences maléfiques toujours redoutées, en particulier des femmes, éveillait un pouvoir attractif... d'où les décorations florales des enfants. ( un intéressant désir de rejet du corporel)
Pour les plumes : des plumes noires pouvaient remplacer les cheveux de ces bracelets et un motif de tatouage en perpétuait le souvenir. Les oiseaux, surtout ceux dont la couleur ou les caractéristiques évoquaient des traits d'analogie avec le comportement de héros ou de divinités, étaient l'objet d'un respect ou d'une quête afin de s'approprier quelques plumes prestigieuses.
Pour les chefs, et chefs de guerre, la coiffe la plus majestueuse : le
ta'avaha était un immense éventail noir au reflet vert constitué de centaines
des plumes : les deux plus longues de la queue des coqs. Il était rehaussé à
l'avant d'une coiffe en croissant souvent recouverte de graines rouges. Les
plastrons, ceintures, etc. de plumes de cette teinte, marquant le tapu rigoureux
entourant les personnes de haut rang, étaient si recherchés que plusieurs
espèces d'oiseaux du Pacifique en pâtirent lourdement.
A défaut, on utilisait ce
qui s'en rapprochait le plus, teinture, graines ou plumes rousses ; plus
tardivement le drap rouge fut un excellent article de troc, d'une valeur bien
inférieure toutefois aux dents de cachalot. Le vert amande des colombes
marquisiennes entrait dans la composition de pa'e ku'a dont le nom évoquait un rouge d'une perfection d'autant plus
inégalable que l'oiseau permettant de les réaliser avait disparu ! Il existait
d'autres ornements de plumes, dont plusieurs portés sur la tête par les hommes
aussi bien que pour les femmes. Les danseurs et danseuses de la danse de
l'oiseau (une des grandes danses marquisiennes avec la danse du cochon)
portaient à chaque main un anneau de plumes de phaéton ou, sinon, une houppette
en plumes ou en barbe de vieillard ...
( source : http://www.marquises.pf )

Ornements d'os, d'ivoire marin, d'écaille ou de nacre étaient aussi nombreux : là encore
l'aspect hautement symbolique de ces matières entrait largement en ligne de
compte dans le choix des tuhuna : leur provenance (la mer, la tortue, un
coquillage, un être humain), leur résistance, leur couleur (blanche pour la
plupart) qui renvoie à la clarté lunaire, à ses fonctions, sa féminité (comme
les coquillages) alternant avec, pour pendant, l'écaille plus sombre, plus
masculine peut-être ou du moins associée au chef...
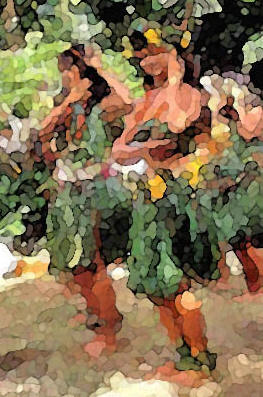
Le chant, la musique, la danse..., tous expriment la vie, peut être parce
qu'ils parlent de la mort et lui sont souvent confrontés, et parce que l'idée
d'entretenir la chaîne de la vie est la force du Marquisien, qui ne cesse de le
marteler dans son art. Elle est sa raison d'être, lui donne sa vigueur... ou la
lui retire s'il se sent condamné.
Elle est le ressort qui lui permet de tenir en ce lieu extrême, en ce bout du
monde polynésien, coupé de tout et de tous parfois.
Le recensement des chants et des danses n'a jamais été fait au moment où ils accompagnaient pleinement la vie des vallées ; lorsqu'il fut tenté par les missionnaires et les premiers ethnologues, ainsi que celui des accompagnements possibles au moyen de flûtes, tambours, conques et multiples sons, exprimés aussi bien par la gorge que par des claquements divers, il amène à en énumérer près d'une centaine, peut être plus. Ils exprimaient avec tant de force et de vérité la vie, l'amour, la détresse... jusqu'à l'extrême, aux yeux des Européens du XIXe et du début du XXe siècle, qu'ils disparurent en quelques dizaines d'années, ne laissant que des souvenirs à leurs descendants comme pour le tatouage, sous l'effet du désarroi devant la mort de ceux qui connaissaient les pas, les mélodies... et des condamnations, exprimées plus ou moins explicitement, avec plus ou moins d'autorité.

L'instrument préféré des hommes et des femmes, notamment des amoureux,
était la flûte ; la plus ancienne était nasale traversière : le pu ihu
; son
usage renaît doucement. C'était un bambou, généralement percé de trois trous et
parfois décoré de fines gravures reprenant des motifs de tatouage. Il exprimait
les sentiments comme on aimait à le faire dans les poèmes et les chants. Il
fallait souffler d'une narine, tandis que l'autre était bouchée avec le pouce de
la main droite ; on jouait avec l'index de la main gauche aidé de deux doigts de
la main droite.
Henri Lavondès, qui dans les années 1970 fit quelques
enregistrements à Ua Pou, vit encore jouer d'une sorte de clarinette : le pu
hakahau, également en bambou et percé de trois à cinq trous. Cette fois la
bouche faisait vibrer une lamelle de bambou soulevée par un cheveu. Cet
instrument masculin, au son grave, servait à accompagner des chants propres à
certaines fêtes.

Les tambours : pahu , de tailles différentes selon l'usage, étaient tous
fabriqués sur le même modèle. Ils étaient creusés dans un tronc de cocotier et recouverts d'une peau de requin tendue par
des tresses en bourre de coco : dont la fixation indirecte à l'aide d'un
laçage et d'un cercle rapporté est particulière aux îles Marquises .
Le secret de la préparation très complexe de la peau s'est perdu il
y a peu ; elle est remplacée à présent par une peau de chèvre.
Les grands
tambours des cérémonies étaient frappés lentement avec les mains et
accompagnaient les chants sacrés, dont ceux relatant la Création. Les tambours
utilisés pour les grandes fêtes, comme les vavana : fêtes de chants, ou
ceux qui servaient pour les danses étaient souvent décorés de sculptures ou de
ligatures ornementales faisant alterner tressage et tapa. Les liens permettant
de tendre la peau pouvaient être garnis de perles d'os


photos empruntées à l'excellent site
http://tahitinui.blog.lemonde.fr
Les chefs, les prêtres, les guerriers ou les pêcheurs au retour de leurs campagnes se servaient de conques pour réunir la population ou l'avertir. Ils les portaient à l'aide d'une tresse souvent faite de tapa. L'embouchure, pratiquée à l'extrémité du coquillage, était complétée par une petite calebasse maintenue par une gomme végétale ; les plus prestigieuses étaient ornées de touffes de cheveux . Il existait aussi des conques faites d'un gros casque et des trompes en bois avec embouchure de bambou. Elles permettaient aux piroguiers, pêcheurs... de communiquer.


Les échasses, (tapu va'e ou va'e ake), étaient un jeu, ou un sport, pratiqué en Polynésie orientale par les enfants et les jeunes adultes, mais l'utilisation d'échasses à manches décorés et étriers sculptés de tikis, dont la pose lançait parfois un défi direct à l'adversaire en lui présentant le postérieur, était une particularité des îles Marquises ; les hommes s'affrontaient jusqu'à ne plus tenir que sur une seule échasse lors de fêtes funéraires.