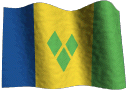|
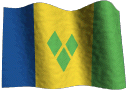
Saint-Vincent-et-les-Grenadines
est un petit État indépendant des Antilles; il est constitué de l'île de
Saint-Vincent (la plus grande du pays) et des îles septentrionales de
l'archipel des Grenadines (une trentaine de petites îles, dont moins d'une
douzaine sont habitées).
Les îles des Grenadines les plus importantes sont
Bequia, Canouan, Moustique, Mayreau et Union. La superficie totale du pays
est de 389 km², l'île de Saint-Vincent représentant 344 km², les
Grenadines, seulement 45 km².
Le pays fait partie des Îles-du-Vent dans la mer des
Caraïbes du Sud-Est et se situe au sud de Sainte-Lucie et au nord de La
Grenade. La Grenade, Sainte Lucie, la Dominique et les Antilles françaises
font également partie des Îles-Sous-le-Vent. La capitale et port
principal, Kingstown, est située sur la côte sud-ouest de l'île de
Saint-Vincent. Le pays est divisé en six paroisses .
L'île de Saint-Vincent fut d’abord habitée par les
Amérindiens cibonay (Cigayos) en provenance d’Amérique du Sud il y a
environ 5000 ans avant notre ère. Un autre peuple amérindien venu du
Venezuela, les Arawaks, leur succéda vers le IIIe siècle de notre
ère avant d’être à son tour supplanté par les Caraïbes, un peuple
guerrier venu au XIVe siècle d’Amérique du Sud par le nord.
L'île de Saint-Vincent fut probablement explorée par
Christophe Colomb qui lui a donné le nom de Saint-Vincent en 1498.
Cependant, la colonisation du pays ne débuta qu'au XVIIIe siècle, les
Caraïbes ayant réussi à protéger Saint-Vincent (alors le Yurumein) de la
présence européenne. En 1660, un traité franco-anglo-caraïbe garantit aux
Caraïbes l’entière propriété des îles de la Dominique et de Saint-Vincent.
En 1675, un bateau hollandais chargé d'esclaves fit naufrage au large des
côtes de Saint-Vincent. Les Caraïbes permirent aux survivants africains de
rester sur l'île. Beaucoup d'entre eux épousèrent des Caraïbes, adoptèrent
leur langue de la famille arawak, leurs coutumes et s'intégrèrent à leur
nouvelle société, provoquant ainsi un métissage afro-amérindien.
Puis la nouvelle que Saint-Vincent (alors l'île de
Yurumein) était devenue un «paradis» pour les esclaves fugitifs (ou
marrons) se répandit parmi les Noirs. D'autres évadés arrivèrent et se
marièrent avec des Caraïbes, ce qui créa un peuple appelé les Garifuna ou
«Caraïbes noirs» ou «Caraïbes rouges» — Black Karibs en anglais; en
espagnol: Caribes Negros, par opposition aux Arawaks appelés
traditionnellement par les Français Caraïbes rouges;
en anglais et en espagnol, les autochtones sont associés aux Asiatiques,
d'où le nom de Yellow Karibs en anglais et de Caribes Amarillos ou jaunes
en espagnol, mais Caraïbes rouges en français sans doute par association
aux Peaux-Rouges du Canada.
Mais la tension finit par monter entre les «Caraïbes jaunes» amérindiens (Yellow
Karibs), ce qui divisa l'île en 1700. Les Caraïbes jaunes s'installèrent à
l'Ouest et les Caraïbes noirs à l'Est. Redoutant d'être dominés par les
Caraïbes noirs, les Caraïbes jaunes autorisèrent les Français à s'établir
1719. Les Français envoyèrent des missionnaires parmi les Caraïbes noirs
et finirent par établir des relations pacifiques avec les deux peuples
caraïbes. Le French patois fit son apparition à cette époque.
Entre 1763 et 1783, la Grande-Bretagne et la France se
disputèrent le contrôle de l'île Saint-Vincent, bien que le traité de
Paris de 1763 ait reconnu les îles Saint-Vincent et la Dominique comme des
îles «neutres». Les Britanniques tentèrent à plusieurs reprises d’occuper
Saint-Vincent, mais les Caraïbes noirs se révélèrent de forts bons
guerriers et réussirent à les repousser. Ils infligèrent même une cuisante
défaite aux Anglais qui durent leur reconnaître le droit d’exister comme
«nation indépendante».
En 1782, le traité de Versailles accorda aux Britanniques la possession de
Saint-Vincent. Les Caraïbes et Garifunas furent alors livrés à leurs pires
ennemis. Les Britanniques fondèrent des plantations de canne à sucre et
firent venir des esclaves africains pour y travailler, ce qui contribua à
l'élaboration du créole à base d'anglais. Cependant, les Français
encouragèrent les Caraïbes noirs à s'opposer à la colonisation
britannique. En 1797, les tribus caraïbes noires, réunies sous le
commandement du chef Joseph Chatoyer, repoussèrent les Britanniques le
long de la côte ouest vers Kingstown. Toutefois, lorsque Chatoyer fut tué
pendant que les Français laissaient tomber leurs alliés, les Caraïbes
noirs se rendirent aux Britanniques.
Ces derniers ne pouvaient accepter que des Noirs soient
libres sur une île vaincue et puissent continuer de vivre parmi eux, comme
des Blancs. Comme c’était la coutume anglaise à l’époque, il leur fallait
liquider ces populations jugées indésirables. Les Anglais pourchassèrent
tous les Garifunas pour les emprisonner, brûlant au passages les maisons,
prenant le bétail et tuant dans la mêlées des centaines de résistants.
Puis, le 15 juillet 1796, Henry Dundas, le secrétaire d’État britannique à
la guerre, ordonna au major-général Sir Ralph Abercromby de transporter
et déporter les 4300 prisonniers garifunas sur l’île déserte de Baliceaux
dans les Grenadines, en attendant qu’une décision soit prise sur leur
sort. Mais sur Baliceaux, la moitié d'entre eux mourut de la fièvre jaune
en raison des mauvaises conditions de détention et d'alimentation. Pendant
ce temps, les Britanniques continuèrent la chasse à l'homme et
détruisirent toutes les cultures de façon à affamer les survivants.
Afin d’empêcher toute nouvelle résistance, le
gouvernement britannique décida finalement de déporter la plupart des
Garifunas. Le 26 octobre 1796, les Britanniques embarquèrent sur des
bateaux 5080 d’entre eux et, après avoir chassé la garnison espagnole qui
occupait l’endroit, les larguèrent sur la petite île hondurienne de Roatán.
Mais, le 11 avril 1797, les Anglais ne laissèrent sur l’île de Roatán que
2248 Garifunas, les autres ayant péri au cours du long voyage. Les
Garifunas qui étaient restés à Saint-Vincent furent conduits dans des
colonies pour travailler dans le nord de l’île (où leurs descendants
demeurent toujours).
Rappelons que cette pratique de la déportation massive était courante à
l’époque, et les Acadiens de la Nouvelle-Écosse au Canada avaient connu le
même sort en 1755.
Cela dit, les Garifunas ne
restèrent pas plus d’une décennie sur Roatán. En bons navigateurs, ils se
fabriquèrent des pirogues, puis se dispersèrent sur les côtes du Belize,
du Honduras et du Nicaragua, pour devenir dorénavant non plus une nation
libre, mais de petites communautés minoritaires. Les Caraïbes restants
furent conduits vers des colonies dans le nord de Saint-Vincent où leurs
descendants demeurent toujours, mais ils ont perdu leur langue ancestrale.
Les Britanniques imposèrent l'anglais comme langue officielle et
ignorèrent le créole des insulaires saint-vincentais. En 1812, sur l'île
Saint-Vincent, une éruption du volcan la Soufrière détruisit les récoltes
et des bâtiments de la colonie. Après l'abolition de l'esclavage en 1834,
les propriétaires de plantation firent venir des travailleurs de l'Inde
orientale comme ouvriers agricoles et comme domestiques. Au cours du
XIXe siècle, de nombreux Portugais s'établirent sur l'île comme
négociants ou commerçants. En 1898, un cyclone endommagea des cultures et,
en 1902, une éruption massive de la Soufrière détruisit des fermes et tua
plus de2000 personnes.
Au début du XXe siècle, Saint-Vincent demeurait encore sous contrôle
britannique, mais l'île obtint la maîtrise croissante de ses affaires
internes. Et c'est le 27 octobre 1979 qu'elle acquit son
indépendance dans le cadre du Commonwealth, sous le nom de
Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amsudant/St-Vincent-Grenadines.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-et-les_Grenadines
|